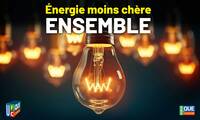Le gaspillage est une des plaies majeures de notre société. La loi Agec (anti-gaspillage et pour une économie circulaire) entend y apporter des remèdes. Avec parfois des effets pervers.
La loi Agec s’applique depuis 2022. Avant cette date, fabricants et distributeurs pouvaient détruire leurs stocks d’invendus. Le gouvernement avait chiffré ce gaspillage à une valeur d’environ 630 millions d’euros de produits. Pour les textiles par exemple, c’était 10 000 à 20 000 tonnes qui étaient ainsi détruites chaque année. L’élimination des produits invendus a donc été interdite depuis le 1er janvier 2022, et les fabricants et les distributeurs doivent désormais donner ou recycler leurs produits invendus.
Pour faire passer la pilule et inciter les professionnels à jouer le jeu, la loi promet, en échange des dons, une ristourne fiscale de 60%. A première vue, l’idée est bonne, vertueuse : moins de gaspillage, puisque les vêtements vont trouver une seconde vie, notamment grâce aux associations solidaires, bénéficiaires des dons.
Une manne financière
 Mais à y regarder de plus près, ce qu’a fait le média d’investigation Disclose avec Reporterre, le système a vite été perverti. Les géants du vêtement ont compris tout de suite le parti qu’ils pouvaient tirer de cette disposition. Puisque le don de vêtements est, pour ainsi dire, rémunéré par le biais de la fameuse ristourne fiscale, les invendus sont devenus de fait une source de revenus pour les grandes marques : une vraie aubaine ! Et on ne parle pas ici de menue monnaie, mais bien de millions d’euros, payés in fine par le contribuable, puisque ce sont des rentrées fiscales en moins.
Mais à y regarder de plus près, ce qu’a fait le média d’investigation Disclose avec Reporterre, le système a vite été perverti. Les géants du vêtement ont compris tout de suite le parti qu’ils pouvaient tirer de cette disposition. Puisque le don de vêtements est, pour ainsi dire, rémunéré par le biais de la fameuse ristourne fiscale, les invendus sont devenus de fait une source de revenus pour les grandes marques : une vraie aubaine ! Et on ne parle pas ici de menue monnaie, mais bien de millions d’euros, payés in fine par le contribuable, puisque ce sont des rentrées fiscales en moins.
Pour les professionnels du secteur, autant produire plus, puisque de toute façon les invendus génèreront des rentrées d’argent. Et voilà, comment, au bout du compte, une loi qui entend mettre fin au gaspillage encourage la surproduction. Un comble !
Des associations submergées
 Et les associations, dans tout ça ? Elles sont véritablement noyées sous les dons, évidemment. Certaines sont obligées de construire des lieux de stockage éphémères (tentes ou barnums), d’autres ne peuvent plus accepter les dons des particuliers ; d’autres enfin se voient contraintes de se débarrasser de leurs surplus, en les détruisant elles-mêmes ou en appelant à l’aide les collectivités locales.
Et les associations, dans tout ça ? Elles sont véritablement noyées sous les dons, évidemment. Certaines sont obligées de construire des lieux de stockage éphémères (tentes ou barnums), d’autres ne peuvent plus accepter les dons des particuliers ; d’autres enfin se voient contraintes de se débarrasser de leurs surplus, en les détruisant elles-mêmes ou en appelant à l’aide les collectivités locales.
Résultat de tout ça : la surproduction explose, alors que l’industrie de la mode est responsable de 8 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Des chiffres suffocants !