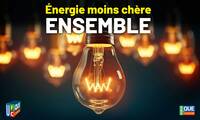Jeux olympiques, coupes du monde de foot et de rugby, Tour de France : chaque année, si on aime le sport, il y a une occasion de se payer une télé grand écran pour profiter du spectacle en format XXL.
Les commerçants le savent bien : rien de tel qu’un grand événement sportif pour doper leurs ventes de téléviseurs. Ils ont donc tendance à proposer des promotions pour appâter le client avec des prix de vente forcément au moins aussi imbattables que l’équipe favorite du supporter acheteur.
Alors quand le vendeur refuse la vente au prétexte que le prix était erroné et qu’il aurait vendu le produit moins cher qu’il ne l’avait acheté, le supporter voit rouge, même si ce sont les Bleus qu’il encourage. Et il n’en démord pas : il doit payer son téléviseur au prix indiqué, c’est la loi !
Pas de revente à perte
En apparence, il n’a pas entièrement tort : l’article L133-1 du Code de la consommation indique en effet qu’en cas de quiproquo, le vendeur est tenu de vendre le produit au prix le plus avantageux pour le client. En principe, face à une erreur de prix en magasin, le consommateur est donc en droit d’exiger d’acheter l’article au prix affiché.
Sauf qu’il y a des exceptions à cette règle : et notamment la revente à perte qui est interdite. Celle-ci n’est autorisée que dans quelques cas très précis : les périodes de soldes, les liquidations totales, ou la revente d’objets devenus technologiquement obsolètes.
Dans l’exemple cité ci-dessus, notre supporter peut donc ranger sa banderole, à moins d’accepter de payer un prix « normal » pour son nouvel écran.
Une protection à long terme
Cette réglementation, que certains pourraient trouver, à première vue, désavantageuse pour le consommateur a en réalité pour but, au contraire, de le protéger. En effet, si la revente à perte était autorisée en France, les plus grosses entreprises pourraient vendre à très bas coût pendant de longues périodes, jusqu’à éreinter la concurrence pour à la fin l’acculer à jeter l’éponge. Certes, dans un premier temps, les consommateurs pourraient se précipiter sur ces enseignes « moins chères », et y trouveraient sans doute temporairement leur compte.
Mais à plus long terme, le match serait vite plié : on se retrouverait avec des entreprises en situation de monopole, avec des marges sans cesse en augmentation et donc des hausses de tarifs vertigineuses (eh oui, on n’est pas dans le monde de la philanthropie !). Sans compter la casse sociale avec des suppressions d’emplois en masse dues aux faillites des concurrents.
Alors, si notre supporter veut encore avoir les moyens de regarder les J0 de 2028, 2032 ou 2036 à la télé, il serait bien inspiré d’accepter de payer le juste prix pour pouvoir regarder sur grand écran la Coupe du monde féminine de rugby 2025, la Coupe du monde masculine de foot en 2026 ou la Coupe du monde masculine de rugby 2027.