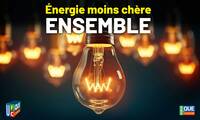Conférence du Professeur Jérôme Thibonnet – Hôtel de Ville de Tours, 13 juin 2025
Un as du tableau périodique, colonne “pédagogie”
Jérôme Thibonnet, c’est un peu le magicien des molécules. Professeur de chimie organique à l’Université de Tours, Il a bien commencé par tremper un doigt en pharmacie, mais une année a suffi pour qu’il bifurque vers la physique-chimie — un domaine bien plus réactif à son goût. Très vite, ce sont les métabolismes cellulaires et les outils d’analyse qui le captivent. Une passion qui ne l’a plus quitté depuis. De là, sa trajectoire trouve la bonne formule : DEA, puis thèse sur les interactions carbone-étain… le tout catalysé par une bourse de la Région Centre.
Après un détour par l’Allemagne pour explorer les liaisons dangereuses carbone, il revient en Touraine et rejoint le CNRS au centre Le Ripault, à Monts. Il y joue les ingénieurs de recherche avant de décrocher un poste de maître de conférences en 2001. Depuis, il dirige une équipe qui planche sur la synthèse de molécules anticancéreuses, notamment contre les cancers du sein et de l’ovaire, en partenariat avec l’INRA. L’apprenti pharmacien refait surface d’une main de maître.
Et malgré ce CV long comme un bras (voire deux), Jérôme Thibonnet n’a rien du professeur prétentieux. Calme, clair, passionné, il a ce petit quelque chose qui transforme la chimie en langage presque courant. Enfin presque.
Une conférence dense mais digeste
 Il en fallait, du talent, pour aborder un sujet aussi costaud que celui des pesticides, le 12 juillet dernier, à l’Hôtel de Ville de Tours, dans le cadre des journées CONS’EAU, organisées par UFC Que Choisir Indre-et-Loire. Devant un public majoritairement novice – mais curieux –, Jérôme Thibonnet a déroulé son exposé façon dompteur de molécules, entre schémas, chiffres et structures chimiques… sans jamais perdre son auditoire. Chapeau prof !
Il en fallait, du talent, pour aborder un sujet aussi costaud que celui des pesticides, le 12 juillet dernier, à l’Hôtel de Ville de Tours, dans le cadre des journées CONS’EAU, organisées par UFC Que Choisir Indre-et-Loire. Devant un public majoritairement novice – mais curieux –, Jérôme Thibonnet a déroulé son exposé façon dompteur de molécules, entre schémas, chiffres et structures chimiques… sans jamais perdre son auditoire. Chapeau prof !
Et pourtant, le contenu avait de quoi donner des sueurs froides.
« En 2023, 64 000 tonnes de produits phytosanitaires ont été vendues en France.
Parmi eux, 44 % sont des herbicides – soit 30 000 tonnes.
Le glyphosate représente à lui seul 5 900 tonnes.
Mais le champion, c’est le prosulfocarbe : 7 400 tonnes, malgré une réglementation de plus en plus corsetée. »
Pesticides : un cocktail pas très festif
Aujourd’hui, l’Union européenne autorise quelque 450 substances herbicides, renouvelables tous les dix ans. Le professeur a attiré l’attention sur la très controversée « loi Duplomb », en discussion au Parlement, qui pourrait faire revenir dans la danse certains produits interdits — comme le métolachlore — au motif que « y’a pas mieux pour l’instant ». Un raisonnement qui fait bondir les ONG, divise les scientifiques et donne des maux de tête aux agriculteurs.
Mais le plus glaçant, ce sont peut-être les résidus. Jérôme Thibonnet a notamment cité l’AMPA, le métabolite du glyphosate, cette petite molécule persistante qui aime squatter les sols, l’eau et même nos assiettes. Discrète, mais coriace. Et toxique, évidemment.
Et ce n’est pas tout. Il a également évoqué une étude italienne récente, publiée le 15 juin 2025 par l’Institut Ramazzini, qui démontre que le glyphosate – pourtant censé cibler les plantes – pourrait en réalité être nocif pour les mammifères. Résultat : leucémies, cancers du sein pour les malheureux cobayes.
« Ironie du sort, glisse le professeur, sans adjuvant, le glyphosate y serait même très moyennement efficace pour la flore, alors que pour la faune il serait bien plus agressif que prétendu ! »
Une alerte, sans sirène mais pas sans effet
 Malgré la gravité du sujet, Jérôme Thibonnet n’a jamais sorti le mégaphone de l’alarmisme. Avec la rigueur du scientifique et la clarté du pédagogue, il a préféré éclairer plutôt qu’inquiéter. Ni culpabilisation, ni simplisme : juste une envie sincère de partager les clés pour mieux comprendre — et mieux agir.
Malgré la gravité du sujet, Jérôme Thibonnet n’a jamais sorti le mégaphone de l’alarmisme. Avec la rigueur du scientifique et la clarté du pédagogue, il a préféré éclairer plutôt qu’inquiéter. Ni culpabilisation, ni simplisme : juste une envie sincère de partager les clés pour mieux comprendre — et mieux agir.
Une démarche en parfaite résonance avec l’esprit des journées CONS’EAU.
En guise de point final, il a choisi une citation sobre mais redoutablement juste, signée Rachel Carson, pionnière de l’écologie moderne : « Le plus inquiétant, c’est ce que l’on ne voit pas. »
Une phrase qui, comme tout bon réactif, continue de faire son effet bien après la fin de la conférence.