Savoir se servir d’un sac en papier
Le sac en papier est à la mode pour ses qualités environnementales. Mais quand on n’a utilisé que des sacs plastique toute sa vie, on risque de se trouver comme une poule devant un cure-dent au moment de glisser ses légumes dedans. C’est du moins ce que semblent penser quelques enseignes de la grande distribution qui ont cru utile de nous rappeler la façon de se servir d’un sac en papier, imprimée sur ledit objet. Il s’agit d’un mode d’emploi en 4 temps.
1. Je prends le sac: eh bien oui, si je ne le prends pas, je risque d’avoir du mal à l’utiliser! Une belle découverte; je n’y aurais pas pensé tout seul!
2. J’élargis l’ouverture du sac: c’est vrai ça! Si je laisse une ouverture trop étroite, mes melons, voire mes pastèques, vont avoir du mal à passer. Il faudra que je pense à en parler à mon fils qui fait du basket: s’il élargit les paniers, il marquera peut-être plus de points!
3. Je mets ma main au-dessous pour éviter que les aliments passent au travers: naïvement, je pensais qu’il fallait mettre sa main au-dessus pour ne pas que les légumes s’envolent.
 4. Je mets mes fruits et légumes: précision importante pour ceux qui pensaient y verser de l’huile en vrac!
4. Je mets mes fruits et légumes: précision importante pour ceux qui pensaient y verser de l’huile en vrac!
J’en conclus tout de même que les générations précédentes étaient sans doute plus intelligentes que nous, puisque j’ai toujours vu mes parents ou grands-parents utiliser un sac en papier sans avoir eu besoin d’une formation préalable.
Mais il y a peut-être des consommateurs qui seront stressés en lisant le mode d’emploi, se disant: « Est-ce que je vais y arriver? » J’aimerais les rassurer en leur disant qu’en cherchant bien sur Internet, ils trouveront peut-être des stages d’utilisation animés par un coach en sacs en papier.
Vous êtes peut-être riche sans le savoir !
On peut, sans le savoir, être titulaire d’un compte épargne, et donc, potentiellement, d’un joli petit pécule. Mais il est désormais plus facile de savoir si on détient un compte dont on ignorait l’existence.
Savez-vous que vous êtes peut-être riche sans le savoir ? Franchement, ça serait trop bête de ne pas en profiter. Cela dit, entendons-nous bien : on ne va pas vous parler du mythique oncle d’Amérique et de ses lingots d’or ou de l’hypothétique tante à héritage avec ses hôtels particuliers dans le XVIe arrondissement de Paris. Seulement d’un possible livret de Caisse d’épargne, par exemple, ouvert par un papy ou une marraine sans que vous en ayez connaissance. Mais quelques centaines ou milliers d’euros, c’est toujours bon à prendre.
Mais comment le savoir ?
 Il existe un fichier des comptes bancaires (ficoba en abrégé) qui recense et identifie tous les comptes courants ou comptes titres ouverts par les particuliers et les personnes morales en France, ainsi que les opérations qui y ont été effectuées (ouverture, modifications, etc.). Il est géré par le fisc et permet à l’administration fiscale de détecter un certain nombre de fraudes. Mais il permet aussi aux particuliers de vérifier s’ils ne seraient pas, à leur insu, titulaires d’un compte dont ils ignoreraient l’existence, ouvert par leurs parents par exemple.
Il existe un fichier des comptes bancaires (ficoba en abrégé) qui recense et identifie tous les comptes courants ou comptes titres ouverts par les particuliers et les personnes morales en France, ainsi que les opérations qui y ont été effectuées (ouverture, modifications, etc.). Il est géré par le fisc et permet à l’administration fiscale de détecter un certain nombre de fraudes. Mais il permet aussi aux particuliers de vérifier s’ils ne seraient pas, à leur insu, titulaires d’un compte dont ils ignoreraient l’existence, ouvert par leurs parents par exemple.
Il est désormais plus simple de se renseigner
Depuis janvier de cette année, il n’est plus nécessaire – il n‘est d’ailleurs plus possible – de s’adresser à la Cnil (Commission nationale informatique et libertés) pour ce genre de renseignements, comme c’était le cas avant.
Désormais, il suffit de se connecter à son espace personnel sur le site impots.gouv.fr. Vous allez dans la rubrique « autres services » puis « accéder au fichier ficoba », et vous remplissez en ligne le fichier de demande d’accès aux comptes ouverts à votre nom, ou à celui de vos enfants mineurs ; Dans un délai d’un mois (trois si la requête est complexe) l’administration fiscale vous fournit une réponse.
Et si je n’ai pas d’espace particulier ?
Dans ce cas, il faut adresser votre demande d’accès au ficoba par courrier à votre centre des impôts. Vous ne devez plus vous adresser à la Cnil, sauf si vous agissez en tant qu’héritier, représentant d’un majeur protégé ou d’une personne morale. Dans ces cas-là, il faut toujours faire la demande par courrier au Centre national de traitement FBFV.
Commandes en ligne non livrées : ne tapez pas sur le transporteur
Même si certains s’y refusent toujours, commander en ligne est devenu un geste banal, voire quasi-quotidien pour certains d’entre nous. Mais le vendeur doit respecter certaines règles.
Prenons un exemple : vous êtes invité à un anniversaire ou à un mariage, et vous commandez le cadeau sur un site marchand. La date de l’événement approche mais vous ne voyez rien venir. Dans la crainte de devoir arriver les mains vides, ce qui ne se fait pas, vous contactez le site sur lequel vous avez commandé pour vous faire rembourser et aller chercher votre cadeau ailleurs, dans l’urgence. On vous répond alors que la commande a bien été envoyée, donc qu’il n’y a pas lieu de vous rembourser, et que si vous voulez avoir des nouvelles de votre colis, vous devez vous tourner vers le transporteur.
Le vendeur est responsable
Eh bien, celui qui vous répond ça a tout faux. La loi prévoit en effet que pour toute commande passée en ligne, c’est le site vendeur qui est responsable de la bonne exécution de la commande du début jusqu’à la fin, même si d’autres prestataires interviennent dans la livraison (un transporteur par exemple). Donc l’acheteur a bien le droit de demander au site vendeur de le rembourser ou d’effectuer une nouvelle livraison, quitte, pour le vendeur, à se retourner ensuite contre le livreur, car ce n’est jamais au client de le faire. Ça, c’est la loi. Mais dans la réalité, hélas, ça se passe bien souvent autrement, et notre association a malheureusement constaté de nombreux cas où des consommateurs se font balader pendant des semaines voire des mois avant d’être effectivement remboursés de leur dû.
Attention aux clauses abusives
Il arrive aussi parfois que le vendeur fasse mentionner dans ses conditions générales de vente (CGV), que le client ne pourra pas le rendre responsable d’un problème de livraison ou encore qu’il serait du ressort du client de faire les démarches pour rechercher le colis. Il s’agit là purement et simplement d’une clause abusive, et donc sans effet.
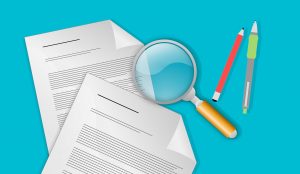 En effet, dans de tels cas, les tribunaux réaffirment régulièrement et très clairement l’impossibilité pour le site vendeur en ligne de rejeter la faute sur le professionnel chargé de la livraison.
En effet, dans de tels cas, les tribunaux réaffirment régulièrement et très clairement l’impossibilité pour le site vendeur en ligne de rejeter la faute sur le professionnel chargé de la livraison.
Pour rejeter sa responsabilité, il faudrait que le site vendeur prouve que le client a délibérément refusé le colis, ou qu’il s’agit d’un cas de force majeure (notons qu’une grève de La Poste n’est pas considérée comme un cas de force majeure).
Il convient donc d’être ferme et vigilant pour faire valoir ses droits de consommateur.
Un dernier conseil avant de cliquer : évitez autant que possible les sites situés à l’autre bout du monde ; en cas de problème, il est quasiment impossible d’exercer le moindre recours.
Et si on parlait de toit ?
Encore une situation abracadabrantesque, mais vécue par un de nos adhérents, où il est question de toit.
Cette petite histoire commence banalement avec le propriétaire d’une maison qui fait démousser son toit. Il fait donc appliquer, par une entreprise, un fongicide sur ses tuiles. L’opération, somme toute assez courante, n’en est pas moins onéreuse puisque la facture s’élève à plus de 3000€. Pour une somme pareille, on peut espérer être tranquille pour un bout de temps.
Une toiture blanche… sans neige
Mais c’est là que les choses se gâtent : la toiture se décolore, et en quelques semaines, elle devient quasiment toute blanche. La tuile, si on peut dire ! Pas content, et c’est un euphémisme, le client contacte l’entreprise pour qu’elle vienne remédier au problème. Celle-ci s’exécute, mais notre adhérent manque de s’étrangler quand il reçoit… une facture de 500€ pour cette nouvelle intervention.
Happy end
Heureusement, suite à une intervention de notre association, tout se termine bien, et l’entreprise cesse de relancer son client pour être payée. En effet, puisqu’il s’agit en l’occurrence d’une malfaçon ou d’une erreur technique de l’entreprise, celle-ci a obligation légale de restituer la toiture dans sa couleur d’origine. Et cela sans frais supplémentaires, cela va de soi. D’autant plus qu’aucun devis n’a été signé pour cette nouvelle intervention. L’entreprise a clairement tout faux.
Pour résumer
Si dans l’affaire ci-dessus s’est bien terminée, il y a quand même quelques enseignements à en tirer.
S’il y a faute ou erreur de l’entreprise, celle-ci doit la réparer sans frais pour le client.
Il ne faut jamais engager de travaux, surtout s’ils sont coûteux, sans la signature préalable d’un devis, qui engage le client et le professionnel pour une somme convenue à l’avance.
Dans le cas de démoussage ou de traitement hydrofuge des toitures, il faut être extrêmement vigilant : les cas de démarchage au porte à porte par des pseudo-professionnels sont hélas fréquents.
Si on constate des malfaçons après des travaux, c’est seulement pendant un an à compter de la réception que l’on peut exiger leur remise en ordre en application de la garantie de parfait achèvement. Cela ne concerne évidemment pas le gros œuvre qui, lui, est couvert par la garantie décennale. Et si une action en justice s’avère nécessaire, elle doit être engagée avant l’expiration de ce délai d’un an.
France, terre de liberté… des prix
A quelques exceptions près, en France, les prix sont libres. A charge pour le consommateur de bien comparer avant d’acheter.
On a tous vécu cette situation au moins une fois dans sa vie : on achète un produit, et quelques jours plus tard, on trouve exactement le même, chez un autre vendeur, moins cher. Avec à la clé le sentiment de s’être fait avoir.
Et pourtant, il n’y a rien à redire à cela puisque depuis bientôt 40 ans, les prix sont libres en France. Ce qui veut dire qu’un commerçant peut vendre son produit au prix qu’il veut, en tenant compte du prix d’achat, de ses charges, des pratiques de la concurrence et, bien sûr, de la marge qu’il entend faire.
 Affichage obligatoire
Affichage obligatoire
Par contre, en contrepartie de cette liberté des prix, le professionnel a obligation d’informer le consommateur sur le prix, avant la vente ou la commande. Cette information doit être faite par un affichage sur ou à proximité immédiate des produits, ou par la remise d’un devis.
Après, c’est au consommateur de jouer son rôle, en comparant les prix, les prestations et conseils.
Si on achète, par exemple, un lave-linge, la situation sera différente selon que le professionnel viendra ou pas vous la livrer et l‘installer. Et si vous vous adressez au dernier commerçant de votre village pour un achat, la volonté de faire vivre la commune peut aussi influer sur votre choix. On le voit, en plus des prix pratiqués, on peut (ou pas) prendre un certain nombre de critères en compte. Et à la fin, on se décide en toute connaissance de cause, pour ne pas éprouver le sentiment toujours désagréable de s’être fait pigeonner dont on parlait en préambule.
Quelques exceptions
Notons toutefois qu’il existe un certain nombre d‘exceptions à ce principe de liberté des prix : c’est le cas notamment des médicaments remboursables ou des livres (soumis à la loi Lang depuis 1981). C’est le cas aussi de certaines prestations pour lesquelles le consommateur n’a pas la possibilité de faire jouer la concurrence : taxis, dépannages sur autoroute, etc.
Et ajoutons pour terminer que si un vendeur vous propose de vous rembourser la différence « si vous trouvez moins cher ailleurs », il s’agit d’un simple geste commercial, et en aucun cas d’une obligation légale.
Assurance : un avenant non avenu et une réponse malvenue
C’est encore une histoire édifiante que nous allons vous raconter aujourd’hui. Celle d’un monsieur qui se fait cambrioler avec effraction. Pour faire bonne mesure, il constate aussi du vandalisme.
Il contacte donc aussitôt son assurance qui lui indique la marche à suivre : dépôt de plainte, visite d’un expert, prise de contact avec des artisans pour avoir un minimum de 3 devis. Il y en a quand même pour plusieurs milliers d’euros de remise en état.
La victime du cambriolage a tout fait bien comme il faut, et il attend, il attend. Et Dieu sait que le temps peut paraître long quand on vit dans un logement sens dessus dessous ! Au bout de 4 mois, le verdict tombe : la garantie vol n’est plus assurée sur son contrat depuis 4 ans, suite à un précédent cambriolage où l’expert avait constaté que les dispositifs de sécurité n’étaient pas conformes aux exigences du contrat. En clair, aucune indemnisation ou prise en charge à attendre !
Un avenant fantôme
Le monsieur se gratte la tête, perplexe : il ne se souvient pas d’avoir été informé d’un quelconque changement des garanties couvertes par son contrat. Il fait des recherches dans ses papiers, rien à faire : pas trace d’un quelconque avenant à son contrat d’assurance. Il demande donc à son agent de lui fournir copie de ce fameux avenant. L’agent, après recherche, ne trouve, lui non plus, aucune trace du document. Il transfère donc la demande au siège de la compagnie. Première réponse : les archives d’il y a 4 ans sont « hors site », donc il va falloir faire preuve de patience. Deux mois plus tard (donc 6 mois après le cambriolage), on l’informe que, bizarrement, on ne trouve pas trace de cet avenant. Et… rien ! Il va falloir que notre assuré se fende d’un nouveau courrier pour enfin, 2 mois plus tard encore, être indemnisé.
Ne jamais rien lâcher !
Car le Code des assurances est formel : : « Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties » (article L. 112-3). Ce qui est, somme toute, logique, puisqu’un contrat, quel qu’il soit, engage les deux parties. Et l’une des deux ne peut évidemment pas en modifier les termes sans que l’autre en soit informée. Et ait signifié son accord par une signature.
Si pour notre victime, l’affaire s’est bien terminée par une indemnisation (au bout de 8 mois de démarches quand même), on constate que cette politique de refus de prise en charge est parfois assez systématique dans certaines compagnies, des assurés finissant (hélas !) par baisser les bras suite à un refus de prise en charge.
On ne peut donc que conseiller aux consommateurs de ne pas renoncer et de faire valoir leurs droits légitimes. Ils peuvent se faire aider, pour cela, par notre association qui, de son côté continue de dénoncer ces refus abusifs de certaines compagnies d’assurances.
Compte joint, mode d’emploi
De nombreuses personnes, notamment vivant en couple, possèdent un compte joint. Mais concrètement, comment ça marche ?
Un compte joint, c’est un compte bancaire ouvert au nom de plusieurs personnes, souvent deux, puisque dans la majorité des cas, ce compte joint concerne des personnes vivant en couple. Ce sont les cotitulaires. Ils doivent être majeurs (ou mineurs émancipés) et sont solidairement responsables du compte joint.
Le fonctionnement, à la base, est simple : chaque cotitulaire, avec sa seule signature, peut faire des retraits d’argent, émettre des chèques, etc. Tous les moyens de paiement peuvent être utilisés par chaque titulaire, excepté la carte bancaire qui reste personnelle.
Quand surgissent les problèmes
Mais que se passe-t-il en cas de problème, un incident de paiement par exemple ? En cas d’incidents de paiement sur un compte joint, la banque peut s’adresser à un ou tous les cotitulaires pour régulariser le compte, peu importe celui qui est à l’origine de l’incident de paiement.
Responsabilité solidaire oblige, en cas de rejet de chèque pour absence de provision sur le compte joint, l’interdiction bancaire concernera chaque cotitulaire, sur tous ses comptes, qu’ils soient joints ou individuels. Seule exception : si un responsable unique de l’interdiction bancaire a été désigné à l’ouverture du compte joint sur lequel un chèque a été rejeté.
Par ailleurs, si le compte est débiteur, chaque cotitulaire est considéré comme étant débiteur.
Toujours solidaires, même après un divorce
 Autre conséquence, et non des moindres de ce fonctionnement solidaire : le compte ne peut pas être clos à la demande d’un des cotitulaires : il faut obligatoirement que tous les cotitulaires manifestent leur accord par écrit. C’est d’ailleurs souvent une pierre d’achoppement en cas de divorce ou de séparation : cette situation n’entraine pas la fermeture d’office du compte joint. Quand les choses se passent mal, il faut à un moment ou à un autre en passer par une demande commune de clôture du compte, faute de quoi on reste lié financièrement, via ce compte joint, à son ex. Avec tous les problèmes qu’on imagine.
Autre conséquence, et non des moindres de ce fonctionnement solidaire : le compte ne peut pas être clos à la demande d’un des cotitulaires : il faut obligatoirement que tous les cotitulaires manifestent leur accord par écrit. C’est d’ailleurs souvent une pierre d’achoppement en cas de divorce ou de séparation : cette situation n’entraine pas la fermeture d’office du compte joint. Quand les choses se passent mal, il faut à un moment ou à un autre en passer par une demande commune de clôture du compte, faute de quoi on reste lié financièrement, via ce compte joint, à son ex. Avec tous les problèmes qu’on imagine.
Il existe également une autre forme de compte commun, il s’agit du compte indivis : c’est un compte collectif qui fonctionne avec l’accord de tous les cotitulaires, toute opération ne peut être réalisée qu’avec la signature de tous les cotitulaires, ou du mandataire désigné par les cotitulaires, mais sans solidarité, contrairement au compte joint. Il est notamment utilisé pour la gestion de copropriétés, par exemple.
Les moyens de paiement et la limite d’un règlement en espèces
Les consommateurs ont trois moyens de paiement chez les commerçants : en espèces, par carte bancaire et par chèque.
 De leur côté, les commerçants peuvent refuser les paiements en carte bancaire et par chèque à la condition expresse d’en avoir informé leur clientèle. La communication, par voie d’affichage (article L112-1 du Code de la consommation), doit être visible, explicite et surtout préalable. En cas d’acceptation de ces deux moyens de paiements, ils sont aussi en droit d’imposer certaines conditions (montant minimum ou maximum et pièce d’identité).
De leur côté, les commerçants peuvent refuser les paiements en carte bancaire et par chèque à la condition expresse d’en avoir informé leur clientèle. La communication, par voie d’affichage (article L112-1 du Code de la consommation), doit être visible, explicite et surtout préalable. En cas d’acceptation de ces deux moyens de paiements, ils sont aussi en droit d’imposer certaines conditions (montant minimum ou maximum et pièce d’identité).
Le paiement en espèces, une obligation…
Par contre, les commerçants ont l’obligation d’accepter le paiement en espèces. C’est d’ailleurs le seul paiement qu’ils ne peuvent refuser. Toutefois, la loi prévoit des exceptions. Un commerçant peut refuser un paiement en espèces si celui-ci est réglé dans une devise étrangère, autre que l’euro.
 Il peut aussi refuser si les espèces sont en trop mauvais état (billets déchirés par exemple), s’il a un doute sur leur authenticité (fausse monnaie) ou s’il y a un nombre trop élevé de pièces (plus de 50 pièces). Dernier cas, un consommateur veut régler sa baguette de pain avec un billet de 50 euros, le boulanger sera en droit de lui refuser le paiement s’il n’a pas suffisamment de monnaie à ce moment-là pour faire l’appoint.
Il peut aussi refuser si les espèces sont en trop mauvais état (billets déchirés par exemple), s’il a un doute sur leur authenticité (fausse monnaie) ou s’il y a un nombre trop élevé de pièces (plus de 50 pièces). Dernier cas, un consommateur veut régler sa baguette de pain avec un billet de 50 euros, le boulanger sera en droit de lui refuser le paiement s’il n’a pas suffisamment de monnaie à ce moment-là pour faire l’appoint.
… mais une exception !
En effet, si le paiement en espèce est le seul à ne pas pouvoir être refusé, il reste néanmoins soumis dans certains cas à un plafond au-delà duquel il n’est plus possible[1]. Ce plafond dépend de la transaction : avec les impôts, vous ne pouvez pas payer plus de 300 € en espèces au guichet, mais ce plafond monte à 3 000€ avec un notaire (payés ou perçus). Avec un professionnel comme un commerçant, le plafond est de 1 000 €. Au-delà, le paiement en espèces n’est pas autorisé.
Dans le cas où aucune de ces exceptions ne s’applique, un consommateur débouté est en droit de le signaler à la direction départementale de la protection des populations d’Indre-et-Loire (DDPP) ou de s’adresser au Défenseur des droits par courrier ou par téléphone.
 Il semblerait, en effet, que des cas de refus de paiement en espèces aient été signalés notamment dans des magasins le dimanche. Le Comité national des moyens de paiement (CNMP), qui rassemble acteurs du paiement, banquiers et commerçants sous la présidence de la Banque de France avait diffusé en 2024 un communiqué de presse dans lequel il rappelait que « les espèces ont cours légal en France. Elles doivent donc être acceptées par les commerçants, tous les jours y compris le dimanche […] ». Les associations représentatives des commerçants s’engageaient alors à « sensibiliser l’ensemble de leurs adhérents sur ce sujet ».
Il semblerait, en effet, que des cas de refus de paiement en espèces aient été signalés notamment dans des magasins le dimanche. Le Comité national des moyens de paiement (CNMP), qui rassemble acteurs du paiement, banquiers et commerçants sous la présidence de la Banque de France avait diffusé en 2024 un communiqué de presse dans lequel il rappelait que « les espèces ont cours légal en France. Elles doivent donc être acceptées par les commerçants, tous les jours y compris le dimanche […] ». Les associations représentatives des commerçants s’engageaient alors à « sensibiliser l’ensemble de leurs adhérents sur ce sujet ».
Il convient de rappeler pour terminer qu’un commerçant qui refuse un paiement en espèce, et dont le refus n’est pas motivé par une des exceptions prévues par la loi, est passible d’une amende de 150 euros.
[1] A noter que le paiement en espèces entre particuliers n’est lui pas limité mais il nécessitera un écrit au-delà de 1 500€ pour prouver la transaction.
Compte bancaire – Ce que votre banque peut faire… ou pas
Entre obligations légales et pratiques bancaires parfois opaques, les relations entre clients et banques suscitent de nombreuses interrogations, voire donnent lieu à des litiges. Relevés de compte, contestation d’opérations, demandes de justificatifs, frais en cas de décès ou de découvert…
Quels sont vos droits ? L’UFC-Que Choisir vous propose de faire un point sur la réglementation et de tester vos connaissances à travers 6 questions.
1. Ma banque peut-elle m’imposer de consulter mes relevés de compte sur Internet ?
2. Puis-je contester une opération de paiement auprès de ma banque n’importe quand ?
3. Ma banque me demande des renseignements que je trouve intrusifs (identité, ressources…) en invoquant la lutte contre le blanchiment d’argent. Dois-je répondre ?
4. Un proche est décédé. Sa banque a facturé des frais à ses héritiers pour clôturer son compte. Est-ce normal ?
5. En cas de découvert bancaire, est-ce que j’aurai des frais ?
6. En cas de faillite des banques, l’argent de mon compte courant est-il protégé ?
Retrouvez également des informations sur les points suivants dans la partie « Le saviez-vous ? » :
- L’offre spécifique pour la clientèle fragile (OCF)
- La mobilité bancaire
- La médiation et le signalement à l’ACPR
- Fraude bancaire : les démarches à effectuer
Enfin dans notre rubrique « Que Choisir pour demain », vous pourrez accéder aux informations complémentaires suivantes :
- Les banques, les placements verts, l’éthique et la protection de l’environnement
- L’UFC-Que choisir mobilisée contre l’écoblanchiment dit « Greenwashing »



