Le lin, la fibre végétale écologique
Le lin est considéré comme le plus vieux textile du monde, avec des utilisations remontant au Néolithique il y a environ 10 000 ans. Les Égyptiens l’utilisaient aussi il y a 8000 ans pour les bandelettes des momies et les vêtements.
Aujourd’hui, le lin est utilisé aussi bien dans le textile que dans l’industrie. Dans le secteur textile, il sert à la fabrication de chaussures en toile, de rubans, de tissus, de pantalons, de chemises ou encore de sacs. Il est apprécié dans la mode responsable. Il est également utilisé pour le linge de maison (rideaux, linge de lit, linge de table) pour son image de noblesse et sa durabilité.
 Dans l’industrie, sa fibre solide et légère est utilisée pour absorber les vibrations, isoler et renforcer des matériaux composites. On le trouve dans les secteurs automobile, hi-tech ou du sport (skis, vélos, raquettes de tennis, planches de surf). Les graines et l’huile sont prisées dans l’industrie agroalimentaire pour leurs bienfaits, et l’huile est aussi utilisée en cosmétique ou pour des peintures. Les fragments de paille (anas) sont valorisés comme paillage horticole, litière, pour la fabrication de panneaux agglomérés ou encore comme combustibles.
Dans l’industrie, sa fibre solide et légère est utilisée pour absorber les vibrations, isoler et renforcer des matériaux composites. On le trouve dans les secteurs automobile, hi-tech ou du sport (skis, vélos, raquettes de tennis, planches de surf). Les graines et l’huile sont prisées dans l’industrie agroalimentaire pour leurs bienfaits, et l’huile est aussi utilisée en cosmétique ou pour des peintures. Les fragments de paille (anas) sont valorisés comme paillage horticole, litière, pour la fabrication de panneaux agglomérés ou encore comme combustibles.
Mais qu’est-ce que le lin ?
Le lin est une matière naturelle végétale. C’est une plante herbacée de la famille des linacées dont il existe près de 200 espèces différentes. Le lin cultivé est aussi appelé « lin commun » ou « lin à fibre » (Linum usitatissimum).
Cette plante a une croissance rapide, atteignant environ un mètre de hauteur en cent vingt jours. Ses fibres naturelles atteignent leur taille maximale au moment de la floraison, sous forme de petites fleurs bleues le plus souvent. Le lin est cultivé principalement dans les zones tempérées proches de la mer, comme la Belgique et le Nord de la France. La France est d’ailleurs le premier pays producteur de lin au monde, représentant 80% de la production mondiale.
Le lin, plus écologique ?
Le lin est une fibre naturelle jugée écologique. Sa culture est peu gourmande en eau et en pesticides. La plante pousse naturellement et ne nécessite aucune irrigation, contrairement au coton. Un hectare de lin retient chaque année 3,7 tonnes de CO2. Les premières étapes de fabrication du lin, comme le teillage, la filature et le tissage, consomment peu d’énergie.
 C’est une ressource « zéro déchet », chaque partie de la plante pouvant être valorisée (graines, fibres, anas). Ses fibres sont recyclables et biodégradables en fin de vie si elles ne sont pas traitées.
C’est une ressource « zéro déchet », chaque partie de la plante pouvant être valorisée (graines, fibres, anas). Ses fibres sont recyclables et biodégradables en fin de vie si elles ne sont pas traitées.
Néanmoins, le lin peut avoir un impact environnemental : au niveau du transport si le lin est transformé loin de son lieu de production, par exemple envoyé d’Europe en Chine, au niveau des phases de transformation avec l’utilisation de sources d’énergie polluantes (comme le charbon) dans les usines dans certains pays avec l’utilisation de produits chimiques pour la coloration par exemple.
Il est donc préférable de choisir du lin certifié par des labels qui garantissent que de la plante au tissu, le lin n’a pas quitté l’Europe, qui promeuvent le circuit court et interdisent l’irrigation ou de se tourner vers le lin biologique.
Coton vs lin
Bien qu’il soit loin d’être autant utilisé que le coton, le lin a le vent en poupe. Il représente 2,4% de la production mondiale de fibres naturelles, contre 75% pour le coton.
 Le lin est réputé pour sa solidité et sa résistance. Il est également léger. Sa capacité d’absorption de l’humidité est plus importante que celle du coton, pouvant absorber jusqu’à 20% d’humidité. Ces propriétés en font une matière de choix pendant l’été, apportant une fraîcheur naturelle aux vêtements sans se déformer. Sa résistance naturelle est due à la longueur et à la structure particulière de ses fibres. Un vêtement en lin peut durer deux fois plus longtemps qu’un vêtement en coton.
Le lin est réputé pour sa solidité et sa résistance. Il est également léger. Sa capacité d’absorption de l’humidité est plus importante que celle du coton, pouvant absorber jusqu’à 20% d’humidité. Ces propriétés en font une matière de choix pendant l’été, apportant une fraîcheur naturelle aux vêtements sans se déformer. Sa résistance naturelle est due à la longueur et à la structure particulière de ses fibres. Un vêtement en lin peut durer deux fois plus longtemps qu’un vêtement en coton.
C’est une matière moins demandée et plus coûteuse à produire que le coton. Son prix plus élevé est dû au lieu de production (principalement Europe), aux étapes de transformation et de confection qui demandent un savoir-faire spécifique et plus de main d’œuvre, et au fait qu’il est plus rare que le coton.
Boutiques duty-free : vraiment moins chères ?
C’est un peu une coutume, quand on revient de vacances à l’étranger, on s’arrête pour faire des achats dans les boutiques duty-free, avec, évidemment une idée préconçue en tête : c’est moins cher. Alors, mythe ou réalité ?

Tous ceux qui se sont retrouvés un jour dans un aéroport international ont forcément croisé des voyageurs surchargés de sac en plastique contenant des bouteilles d’alcool, des parfums ou du tabac, et se sont immanquablement demandé si les marchandises étaient vraiment moins chères dans ces fameux magasins « duty-free ».
Comme duty-free signifie, en bon français, hors-taxe, on a intuitivement envie de répondre oui. Les magasins en question, situés dans des zones internationales, généralement aéroports ou ports maritimes, n’ont en effet pas à appliquer les taxes en vigueur dans le pays où ils se trouvent. Donc qui dit absence de taxes devrait signifier prix moins élevés. En principe.
Une réalité très contrastée

Mais en principe seulement, car ce n’est pas si évident que ça en a l’air. En effet, comme ces fameuses boutiques bénéficient d’un emplacement premium dans une zone hyper-fréquentée, l’aéroport où elles sont situées leur fait payer un loyer très élevé. Et au final, comme on s’en doute, les prix des marchandises à la vente s’en ressentent.
Donc, absence de taxes d’un côté, charges plus importantes de l’autre. Tout compte fait, il est parfois plus intéressant de faire ses emplettes dans les commerces traditionnels plutôt que d’attendre le dernier moment à l’aéroport, d’autant qu’une fois qu’on est dans la zone de transit, on n’a plus guère le choix de retourner en ville dans une petite boutique.
Concrètement, on ne peut donner que quelques tendances. Le plus souvent (mais ce n’est pas une vérité absolue), alcool et confiseries sont moins chers en supermarchés, alors que cigarettes et parfums sont moins onéreux en boutique hors-taxe.
Quelques conseils
 N’hésitez pas à utiliser votre smartphone pour comparer les prix avec ceux de magasins traditionnels français. Quel intérêt auriez-vous à acheter une bouteille de whisky, par exemple, si vous pouvez trouver la même moins cher dans le premier hypermarché que vous trouverez à votre retour ?
N’hésitez pas à utiliser votre smartphone pour comparer les prix avec ceux de magasins traditionnels français. Quel intérêt auriez-vous à acheter une bouteille de whisky, par exemple, si vous pouvez trouver la même moins cher dans le premier hypermarché que vous trouverez à votre retour ?
Pour ce qui est des cigarettes, le tabac étant très taxé en France, vous aurez avantage à les acheter en boutique hors taxe… ou à arrêter de fumer, ce qui est encore mieux.
Pour ne pas devoir acquitter des droits ou des taxes à votre retour en France, renseignez-vous sur les seuils de franchise appliqués aux achats à l’étranger.
Annulation des vols et indemnisations
Deux consommateurs nous ont écrit pour nous faire part de leur galère de transport aérien. Voici leurs témoignages. « Je devais partir à Porto en septembre dernier, et mon vol a été annulé, à partir de Tours, car l’aéroport de Porto était inaccessible du fait de nuages de fumée avec les incendies qui sévissaient. Je n’ai toujours rien touché ! » (Pascale de Tours) ; » Mon avion en provenance de Marrakech n’a pu atterrir à Tours, à cause du brouillard. Nous avons été déroutés à Rennes. J’ai perdu une journée de travail, avec le décalage induit. Comment récupérer une indemnité ? » (Philippe, de Montbazon ).
Tout d’abord, petit rappel : il y a annulation de vol quand le vol prévu initialement n’a pas été effectué. Il y a retard quand un avion arrive à sa destination avec plus de trois heures de retard. Dans les deux cas, les indemnisations prévues par la législation européenne dépendent du pays de départ et d’arrivée du vol ainsi que de la nationalité de la compagnie aérienne.
En cas d’annulation
 Dans le cas de nos deux voyageurs, la compagnie Ryanair est irlandaise et donc européenne. Les modalités de leur vol entrent bien dans la possibilité d’une indemnisation. Pour rappel, en cas d’annulation, la compagnie aérienne doit vous proposer un autre vol dans les mêmes conditions, soit vous rembourser votre billet dans un délai de sept jours. De plus, elle doit vous verser une indemnité forfaitaire qui dépend du kilométrage : par exemple 250 € pour les vols de moins de 1 500 km ou 400 € pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km. Elle doit aussi, en cas de réacheminement par un autre vol, prendre en charge les frais inhérents au changement : restauration, hôtel, boissons etc.
Dans le cas de nos deux voyageurs, la compagnie Ryanair est irlandaise et donc européenne. Les modalités de leur vol entrent bien dans la possibilité d’une indemnisation. Pour rappel, en cas d’annulation, la compagnie aérienne doit vous proposer un autre vol dans les mêmes conditions, soit vous rembourser votre billet dans un délai de sept jours. De plus, elle doit vous verser une indemnité forfaitaire qui dépend du kilométrage : par exemple 250 € pour les vols de moins de 1 500 km ou 400 € pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km. Elle doit aussi, en cas de réacheminement par un autre vol, prendre en charge les frais inhérents au changement : restauration, hôtel, boissons etc.
En cas de retard
En cas de retard de plus de trois heures à l’arrivée, le consommateur voyageur a les mêmes droits qu’en cas d’annulation notamment en termes d’indemnisation.
Malheureusement, dans les cas cités en témoignage, les raisons de l’annulation pour l’un et du retard du vol pour l’autre, sont liées à des circonstances exceptionnelles : catastrophe naturelle avec les fumées d’incendies pour le premier, condition météorologique pour le deuxième. Selon le Règlement européen n°261/2004 relatif aux droits des passagers aériens, ces circonstances extraordinaires libèrent les compagnies aériennes de leur obligation de verser une quelconque indemnité aux passagers. En effet, la réglementation européenne considère que les compagnies aériennes ne sont pas responsables de ces circonstances extraordinaires.
 Dans le cas du vol pour Porto, c’est, soit la compagnie Ryanair qui a jugé le vol trop risqué, soit l’aéroport de Porto lui-même qui a décidé de stopper le trafic. Pascale, notre voyageuse, n’indique pas si, en raison de son vol annulé, elle a renoncé à son voyage, si elle s’est rendue sur place par un autre moyen de transport ou si elle a perdu des nuitées d’hôtel à Porto. En effet, en cas d’annulation de vol même pour circonstances exceptionnelles, la compagnie aérienne devait lui proposer soit le remboursement de son billet, soit un autre vol. Dans le cas d’un autre vol, elle devait lui proposer repas, boissons et hébergement (dans la limite du raisonnable), appels téléphoniques jusqu’au nouveau vol. Dans le cas où notre lectrice a renoncé à son voyage, le billet d’avion aurait dû déjà lui être remboursé.
Dans le cas du vol pour Porto, c’est, soit la compagnie Ryanair qui a jugé le vol trop risqué, soit l’aéroport de Porto lui-même qui a décidé de stopper le trafic. Pascale, notre voyageuse, n’indique pas si, en raison de son vol annulé, elle a renoncé à son voyage, si elle s’est rendue sur place par un autre moyen de transport ou si elle a perdu des nuitées d’hôtel à Porto. En effet, en cas d’annulation de vol même pour circonstances exceptionnelles, la compagnie aérienne devait lui proposer soit le remboursement de son billet, soit un autre vol. Dans le cas d’un autre vol, elle devait lui proposer repas, boissons et hébergement (dans la limite du raisonnable), appels téléphoniques jusqu’au nouveau vol. Dans le cas où notre lectrice a renoncé à son voyage, le billet d’avion aurait dû déjà lui être remboursé.
Pour Philippe, c’est le brouillard qui a, à plusieurs reprises cet hiver et au printemps, bouleversé le transport aérien à Tours (avec plusieurs vols détournés) mais aussi dans toute la France, voire l’Europe. Des centaines de vols retardés ou détournés ont été enregistrés. Philippe indique avoir été détourné vers Rennes et même s’il a été ensuite acheminé à Tours, cela a occasionné un retard à son retour à son domicile et surtout à son travail.
Par le contrat qui lie la compagnie à ses passagers, celle-ci a pour obligation de les amener à destination. Elle n’est pas tenue pour responsable des dépenses qui ne sont pas liées à ce contrat, encore plus dans le cas de circonstances exceptionnelles. La compagnie aérienne est supposée non responsable des engagements pris par les passagers par exemple, des nuitées manquées, un concert ou un match raté, des journées de location de voiture perdues, ou pour notre lecteur, la perte d’un jour de travail. De plus, au vu du cas de force majeur qu’est le brouillard, celui-ci n’a malheureusement droit à aucune indemnité de la part de Ryanair.
En conclusion
 En conclusion, les circonstances exceptionnelles ne permettent malheureusement pas d’obtenir d’indemnité pour les passagers victimes d’annulation de vol ou de retard que ce soit avec la compagnie Ryanair ou avec une autre compagnie aérienne. Pour les autres cas qui sont éligibles à indemnisation (et seulement ceux-là) avec la compagnie Ryanair, notre association l’UFC-Que Choisir peut présenter auprès de la compagnie votre demande d’indemnisation amiable. Pour cela, vous pouvez vous connecter à la plateforme mise en place https://www.quechoisir.org/arbre-ryanair-n148356/.
En conclusion, les circonstances exceptionnelles ne permettent malheureusement pas d’obtenir d’indemnité pour les passagers victimes d’annulation de vol ou de retard que ce soit avec la compagnie Ryanair ou avec une autre compagnie aérienne. Pour les autres cas qui sont éligibles à indemnisation (et seulement ceux-là) avec la compagnie Ryanair, notre association l’UFC-Que Choisir peut présenter auprès de la compagnie votre demande d’indemnisation amiable. Pour cela, vous pouvez vous connecter à la plateforme mise en place https://www.quechoisir.org/arbre-ryanair-n148356/.
Garantie légale de conformité : rester sourd aux airs de pipeau
La garantie légale de conformité (GLC) est un droit pour tous les consommateurs. Pour le faire valoir, il faut parfois savoir rester sourd à des arguments fallacieux de certains vendeurs.
C’est l’histoire, hélas vécue, d’une dame qui se rend dans un magasin de produits de jardins pour acheter un parasol. En ces périodes caniculaires, rien de plus normal. Arrivée chez elle, elle le déplie sur sa terrasse et passe une agréable soirée sur une terrasse bien ombragée. Tout va bien : la dame est satisfaite de son achat. Le lendemain matin, alors que le soleil commence à se faire ardent, la dame redéplie son parasol et là, surprise ! Elle constate qu’une des baleines a déjà rendu l’âme. Moins de 24 heures après l’achat, c’est quand même un peu court !
Elle décide donc de retourner au magasin avec l’objet défectueux. Et là, quand elle explique le problème, elle s’entend répondre : « Ah oui, mais je ne vais rien pouvoir faire parce que la personne qui s’occupe des retours est en congés. Il faudra que vous reveniez quand elle sera là ! » Un peu contrariée, pour ne pas dire plus, la dame se rend dans un autre magasin pour acheter un autre parasol « en attendant ».

GLC: un droit pour tous…
Cette petite histoire édifiante nous rappelle que de nombreux vendeurs sont totalement en-dehors des clous. La garantie légale de conformité, qui s’applique à tous les produits achetés auprès d’un professionnel, obéit à des règles précises qu’aucun vendeur n’est censé ignorer.
D’abord, elle dure 2 ans dans le cas d’un produit neuf, et ne s’applique pas qu’au produit lui-même. Elle concerne aussi l’emballage, l’installation quand elle est assurée par le vendeur, et même les instructions de montage : si vous montez votre meuble de travers parce que la notice de montage était écrite dans un sabir incompréhensible, vous bénéficiez de la GLC. Donc si on vous propose une « garantie maison » de 2 ans, elle est totalement inutile, c’est du pipeau !
Ensuite, c’est au vendeur qu’il faut s’adresser en cas de problème, comme l’a d’ailleurs bien fait la dame. Trop souvent encore, on entend des vendeurs botter en touche en disant : « Adressez-vous au constructeur ! » Là encore, pipeau !
… sans attendre la fin des vacances !
Le vendeur a obligation de remplacer ou réparer le produit dans un délai de 30 jours et sans frais. Dans le cas de notre acheteuse, ce délai part bien du jour où elle est retournée au magasin avec son parasol cassé, et non du jour où l’employé préposé aux retours rentrera de vacances. Et le magasin a obligation de prendre en compte immédiatement la réclamation de la cliente. Donc la réponse qui a été faite à la dame : « Revenez quand mon collègue sera de retour », toujours pipeau !
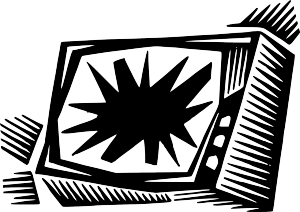 Et pour compléter la partition, ajoutons-y cette réponse déjà entendue : « Si c’est cassé, c’est que vous ne l’avez pas bien utilisé ! » Si le vendeur ne prouve pas ce qu’il avance, pipeau, pipeau, pipeau !
Et pour compléter la partition, ajoutons-y cette réponse déjà entendue : « Si c’est cassé, c’est que vous ne l’avez pas bien utilisé ! » Si le vendeur ne prouve pas ce qu’il avance, pipeau, pipeau, pipeau !
La garantie légale de conformité est un droit que le consommateur doit pouvoir faire valoir quelles que soient les circonstances : soyez-y donc vigilants… sauf évidemment si vous vouez un véritable culte aux airs de pipeau !
Train – Les droits des passagers
Attiré par un prix promotionnel, par commodité ou geste écologique, vous avez choisi de voyager en train. Toutefois, votre transport peut être perturbé (train annulé, bagage oublié, chute, etc.).
En tant que voyageur, vous avez des droits. L’UFC-Que Choisir vous propose de faire le point sur la réglementation à travers 6 questions.
1. La SNCF m’a informé à midi par SMS que mon train de ce soir était annulé. Doit-elle me proposer un réacheminement ?
2. J’ai raté ma correspondance car mon train Intercités est arrivé en retard. J’ai dû louer une voiture pour me rendre à destination. Puis-je être remboursé de mes frais ?
3. J’ai raté mon vol car le TGV Ouigo que j’ai réservé pour me rendre à l’aéroport est arrivé en retard. Puis-je obtenir de la SNCF le remboursement de mon billet d’avion ?
4. J’ai oublié dans un TGV Inoui un petit sac à dos sous mon siège. Il n’a pas été retrouvé à l’arrivée. Ai-je un recours contre la SNCF ?
5. Un contrôleur de la SNCF m’a mis une amende car mon billet était pour le train précédent. Ayant un abonnement, j’ai refusé de la régler à bord. Puis-je la contester ?
6. J’ai chuté en descendant du TER. J’ai été hospitalisé et mes vacances ont été gâchées. Puis-je obtenir une indemnisation de la SNCF ?
Vous trouverez toutes les réponses en cliquant Train – Les droits des passagers

Retrouvez également des informations sur les points suivants dans la partie « Le saviez-vous ? » :
- La prescription des actions en justice des voyageurs
- La médiation SNCF Voyageurs
- Un billet électronique contrôlable à tout moment
- Pensez à utiliser le billet de congé annuel de la SNCF !
Enfin dans notre rubrique « Que Choisir pour demain », vous pourrez accéder aux informations complémentaires suivantes :
- Prenez le train : c’est bon pour la planète !
- Mobilité verte : emporter votre vélo dans le train
- Les demandes de l’UFC-Que Choisir
Vide-greniers : des règles à respecter
L’été est la saison par excellence des vide-greniers, rendez-vous privilégié de tous ceux qui ont quelque chose à vendre… ou à acheter.
Tout cela doit se faire, naturellement, dans les règles.
– La première d’entre elles, c’est qu’on n’a le droit de faire que deux vide-greniers dans l’année. Lors de l’inscription, vous devez être inscrit sur un registre, et vous devez attester sur l’honneur que vous n’avez pas déjà fait ces fameux deux vide-greniers dans l’année.
 – La deuxième règle de base concerne les objets que vous vendez. Le Code du commerce précise que vous ne devez vendre que des objets « personnels et usagés ». Ça veut dire notamment que si vous créez, pour vos loisirs, des petits objets, vous n’avez pas le droit de les vendre dans un vide-greniers, à moins de vous déclarer comme professionnel. Outre ces produits artisanaux fabriqués par vos soins, vous ne pouvez pas vendre :
– La deuxième règle de base concerne les objets que vous vendez. Le Code du commerce précise que vous ne devez vendre que des objets « personnels et usagés ». Ça veut dire notamment que si vous créez, pour vos loisirs, des petits objets, vous n’avez pas le droit de les vendre dans un vide-greniers, à moins de vous déclarer comme professionnel. Outre ces produits artisanaux fabriqués par vos soins, vous ne pouvez pas vendre :
– des produits alimentaires préparés (plats cuisinés, gâteaux, confitures par exemple), pour des raisons de sécurité alimentaire évidentes ;
– des objets dangereux (armes), de l’alcool, des médicaments ou du tabac ;
– des objets neufs encore dans leur emballage ;
– des contrefaçons (sacs de marque contrefaits par exemple).
– La troisième règle concerne l’organisation : vous n’avez pas le droit de réunir vos voisins et amis « à l’arrache » pour déballer sur la voie publique. Le vide-greniers doit être déclaré préalablement au maire de la commune. Si vous oubliez ce passage obligatoire par la case mairie, ça peut vous coûter 15000 € d’amende.
Enfin, dernière chose bonne à savoir : le principe est que les revenus engrangés dans un vide-greniers ne sont pas à déclarer, et donc pas imposables. Mais évidemment, comme à toute règle, il y a des exceptions. En fait, il n’y en a que deux : la première, c’est quand vous vendez des métaux précieux ; et la seconde, c’est quand vous vendez un objet d’une valeur de plus de 5000€. Mais sont exonérés les meubles, les voitures et l’électroménager.
Des bonnes affaires dans les vide-greniers ?
 Il faut surtout se lever tôt car les professionnels, qui réprouvent officiellement le travail au noir, n’ont pourtant aucun scrupule à se précipiter dès potron-minet dans ces ventes pour y écumer la plus belle marchandise «au cul de la voiture ».
Il faut surtout se lever tôt car les professionnels, qui réprouvent officiellement le travail au noir, n’ont pourtant aucun scrupule à se précipiter dès potron-minet dans ces ventes pour y écumer la plus belle marchandise «au cul de la voiture ».
Pour les collectionneurs, ils l’affirment, il est toujours possible de faire des trouvailles car tout se collectionne : des hameçons aux œufs Kinder, en passant par les carnets de bal, les plaques minéralogiques ou les muselets et autres capsules de bouchons de champagne.
Des conseils pratiques ?
Si vous exposez, réservez le plus tôt possible votre emplacement, car certains vide-greniers sont très courus. Il faut aussi bien s’organiser en amont : fond de caisse en petite monnaie, étiquettes pour les prix, sachets, etc. Prévoir un équipement confortable car la journée est généralement longue. Pour les chineurs, n’attendez pas la fin de journée, n’hésitez pas à marchander, cela fait aussi partie du plaisir du vide-greniers mais sans exagération : on ne négocie pas pour un objet à 1 € et on garde le sourire !
Voyage organisé : le diable se cache dans les détails…
Voyage tout organisé ou départ à l’aventure, chacun son programme…mais le voyage organisé reste la formule préférée des Français.
On a l’habitude de parler de voyage organisé, mais en fait c’est ce qu’on appelle voyage au forfait puisque cela combine au moins deux types de services de voyage (transport, hébergement, visites, etc.), le tout vendu à un prix tout compris.
Quels avantages ?
 Le principal avantage est que tout est organisé à l’avance, ce qui rassure et permet de partir l’esprit libre : pas besoin de penser à louer une voiture, à trouver un hôtel… Le voyage en groupe offre aussi la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, donc c’est un bon choix pour les personnes qui partent seules. Les voyages organisés permettent aussi de découvrir des pays, des régions et des lieux auxquels on n’aurait pas forcément pensé.
Le principal avantage est que tout est organisé à l’avance, ce qui rassure et permet de partir l’esprit libre : pas besoin de penser à louer une voiture, à trouver un hôtel… Le voyage en groupe offre aussi la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, donc c’est un bon choix pour les personnes qui partent seules. Les voyages organisés permettent aussi de découvrir des pays, des régions et des lieux auxquels on n’aurait pas forcément pensé.
Et puis surtout le prix est souvent avantageux. Les personnes maitrisent mieux leur budget. Et on trouve des voyages pour tous les budgets…
Côté inconvénients ?
Cela peut ne pas convenir à des personnes qui préfèrent maitriser leurs visites, leurs déplacements, qui préfèrent partir à l’aventure. Question d’envie et de façon de vivre ses vacances.
Côté informations, une obligation d’information
 C’est le Code du tourisme qui précise la nature des informations obligatoirement délivrées par écrit avant la signature du contrat. La plupart concernent le voyage lui-même : dates, destination, nature et confort de l’hébergement, restauration, visites, conditions d’annulation, modalités de révision des prix.
C’est le Code du tourisme qui précise la nature des informations obligatoirement délivrées par écrit avant la signature du contrat. La plupart concernent le voyage lui-même : dates, destination, nature et confort de l’hébergement, restauration, visites, conditions d’annulation, modalités de révision des prix.
Mais le futur vacancier doit aussi être informé des formalités administratives et sanitaires à accomplir, de la possibilité de souscrire un contrat d’assurance annulation ou un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers comme le rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Mais aussi, très important en cas de voyage en avion, le client doit être informé de l’identité du transporteur aérien pour chaque vol.
Oui mais…
Avant de souscrire, il faut faire attention à bien choisir et surtout bien lire le descriptif du voyage ou du séjour car certains n’incluent pas toujours le voyage, les repas ou encore les activités.
 Un de nos adhérents nous a envoyé récemment une publicité pour un voyage de 15 jours à Rhodes à partir de 249 € par personne : une très bonne affaire me direz-vous ! Mais pas si bonne tout compte fait car ce « à partir » signifie en fait que ce n’est pas le prix que le vacancier va payer : déjà cela dépend de la date de son départ puisque pour un départ en avril ou en mai par exemple, il faut compter un supplément de 204 € par personne.
Un de nos adhérents nous a envoyé récemment une publicité pour un voyage de 15 jours à Rhodes à partir de 249 € par personne : une très bonne affaire me direz-vous ! Mais pas si bonne tout compte fait car ce « à partir » signifie en fait que ce n’est pas le prix que le vacancier va payer : déjà cela dépend de la date de son départ puisque pour un départ en avril ou en mai par exemple, il faut compter un supplément de 204 € par personne.
Et puis, il y a les toutes petites lignes, celles que l’on ne peut lire qu’avec une loupe : là, on découvre qu’en Grèce, de mars à octobre, il y a une taxe climatique pouvant atteindre 15 € par chambre et par nuit qui s’ajoute.
Et ce n’est pas tout: quand on lit attentivement le programme, durant la première semaine de voyage culturel, seuls les petits déjeuners sont comptabilisés mais il est possible de « profiter d’une offre préférentielle très avantageuse » avec le forfait gastronomie, une demi-pension à 159 € par personne (!). Pareillement pour la deuxième semaine de détente dans un hôtel 4 étoiles où seules les nuits sont offertes… il faudra payer en plus les repas qui ne sont pas compris et pour peu que la résidence soit excentrée, loin de tout, le vacancier devra en passer par le restaurant de de l’hôtel quel que soit le prix de la restauration.
En conclusion, mieux vaut lire toutes les lignes de l’offre pour être certain que les vacances à Rhodes ne vous resteront pas en travers de la gorge.
Un anniversaire en grandes Pompes…Funèbres intercommunales
La semaine dernière, les Pompes Funèbres Intercommunales de l’agglomération tourangelle fêtaient leurs 25 ans.
En effet, la SAEM « P.F.I », Société Anonyme d’Economie Mixte a été fondée en 1998 par la ville de Tours et onze communes associées. Actuellement, cette société compte 79,13 % d’actionnaires du secteur public et 20,87 % d’actionnaires du secteur privé. De plus, la SAEM « PFI » assure la gestion du crématorium de Tours.
A l’occasion de cet anniversaire, une conférence/table ronde était organisée à l’hôtel de ville de Tours. Notre association, l’UFC-Que Choisir 37 était invitée à y participer.
Dans une chaleur étouffante, les différents intervenants ont pris la parole devant une assemblée attentive. Les débats étaient animés par Aurélien Legendre, animateur de Val de Loire TV et ponctuées par les explications de Manon Moncoq, doctorante en anthropologie.
Pour rappel
 Le marché du funéraire représente aujourd’hui environ 2.7 milliards d’euros de chiffres d’affaires annuel avec une progression de 4 % environ par an. C’est une activité qui ne connait pas la crise en raison du vieillissement de la population (638 000 décès en 2023). Actuellement ce business de la mort est dominé par trois groupes :
Le marché du funéraire représente aujourd’hui environ 2.7 milliards d’euros de chiffres d’affaires annuel avec une progression de 4 % environ par an. C’est une activité qui ne connait pas la crise en raison du vieillissement de la population (638 000 décès en 2023). Actuellement ce business de la mort est dominé par trois groupes :
-OGF (PFG, Dignité funéraire…) avec 25 % du marché (détenu en majorité par un fonds d’investissement canadien) ;
– Funecap (Roc-Eclerc, Pascal Lecler, Rebillon) avec 11 % du marché ;
– le réseau Le Choix Funéraire.
Le secteur public ne représenterait que 7 % du marché.
Une soirée instructive
 Cette soirée a été l’occasion pour la représentante de notre association l’UFC-Que Choisir, de revenir sur deux points. Le premier point est le coût parfois exorbitant des obsèques. Dans notre enquête de 2019 sur les pompes funèbres, le coût des obsèques était en progression entre 2014 et 2019 de 14 % pour les inhumations et de 10 % pour les crémations alors que l’inflation n’était que de 3.9% pendant cette même période. Selon une enquête de Silver Alliance sur 2023 sur le sujet, une inhumation coûte en moyenne 5 044 €, celui d’une crémation revient en moyenne à 4 434 €. Si ce marché n’échappe pas à l’augmentation générale des prix (le bois, le gaz, l’électricité, la masse salariale…), ces tarifs restent incompréhensibles pour les consommateurs ; Surtout quand on voit dans ces mêmes enquêtes, de forts écarts de prix pour les mêmes prestations selon les opérateurs mais aussi selon les régions. Se pose alors la question du juste prix et des marges réalisées par certaines enseignes !
Cette soirée a été l’occasion pour la représentante de notre association l’UFC-Que Choisir, de revenir sur deux points. Le premier point est le coût parfois exorbitant des obsèques. Dans notre enquête de 2019 sur les pompes funèbres, le coût des obsèques était en progression entre 2014 et 2019 de 14 % pour les inhumations et de 10 % pour les crémations alors que l’inflation n’était que de 3.9% pendant cette même période. Selon une enquête de Silver Alliance sur 2023 sur le sujet, une inhumation coûte en moyenne 5 044 €, celui d’une crémation revient en moyenne à 4 434 €. Si ce marché n’échappe pas à l’augmentation générale des prix (le bois, le gaz, l’électricité, la masse salariale…), ces tarifs restent incompréhensibles pour les consommateurs ; Surtout quand on voit dans ces mêmes enquêtes, de forts écarts de prix pour les mêmes prestations selon les opérateurs mais aussi selon les régions. Se pose alors la question du juste prix et des marges réalisées par certaines enseignes !
 Notre deuxième point était le flou existant sur les devis. La réglementation impose aux entreprises du secteur de respecter un devis type (fixé par un arrêté du 23 août 2010 et changé au 1 er juillet 2025). Si cette obligation a été une avancée vers plus de clarté, elle ne règle pas tout. Le devis reste le gros point noir de la profession. Son encadrement avait pour objectif de faciliter la comparaison entre concurrents mais ce modèle de document, voulu par les grandes entreprises présente de gros handicaps : termes peu explicatifs, classification des prestations peu logiques.
Notre deuxième point était le flou existant sur les devis. La réglementation impose aux entreprises du secteur de respecter un devis type (fixé par un arrêté du 23 août 2010 et changé au 1 er juillet 2025). Si cette obligation a été une avancée vers plus de clarté, elle ne règle pas tout. Le devis reste le gros point noir de la profession. Son encadrement avait pour objectif de faciliter la comparaison entre concurrents mais ce modèle de document, voulu par les grandes entreprises présente de gros handicaps : termes peu explicatifs, classification des prestations peu logiques.
En 2014, une enquête de Que Choisir révélait que 80 % des 1 132 devis récoltés auprès de plusieurs sociétés de pompes funèbres n’étaient pas conformes à la réglementation. 26% n’avaient pas remis de devis. Dans l’enquête de 2019, la situation s’améliorait puisqu’ils n’étaient plus que de 22 % mais 1 opérateur sur 5 ne respectait toujours pas la loi (documents administratifs manquants, envoi ultérieur, pas de contrat, pas de devis, devis payant…). Dans les devis récoltés, 65 % n’étaient pas adaptés. Seuls 9% étaient totalement conformes et 26 % partiellement conformes. De plus, lors d’un décès, les familles ne sont pas toujours informées des prestations obligatoires, imposées par la loi et celles non obligatoires mais qui alourdissent souvent la facture.
Secteur privé vs secteur public
Toutes ces données posent question sur ce secteur spécialisé car certaines entreprises privées font de très belles et injustifiées marges ; des marges d’autant plus honteuses qu’elles sont réalisées sur le dos d’une clientèle vulnérable, en situation d’urgence et de faiblesse au moment d’un deuil.
 Face à la concurrence, le funéraire public peut se distinguer par une éthique portant les valeurs du service public : moins de prestations non obligatoires effectuées, transparence des tarifs (votés en conseil municipal ou métropolitain selon), service gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes…
Face à la concurrence, le funéraire public peut se distinguer par une éthique portant les valeurs du service public : moins de prestations non obligatoires effectuées, transparence des tarifs (votés en conseil municipal ou métropolitain selon), service gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes…
De plus, si toutes enseignes confondues, 83% des sondés sont satisfaits, voire très satisfaits des prestations (enquête 2019), c’étaient lors de cette enquête, les opérateurs publics qui répondaient le mieux aux attentes des familles. De quoi faire sourire le directeur général des PFI de l’agglomération tourangelle, M. DRENEAU et toute son équipe.
Tous les chemins mènent à l’arôme… mais sont parfois tortueux !
Quand on mange une glace à la vanille, a-t-on la certitude de manger vraiment de la glace avec de la vanille dedans ? En fait, rien n’est moins sûr.
Par les temps qui courent, se rafraichir en mangeant une glace est un petit plaisir qu’on a du mal à se refuser. Prenons par exemple une glace à la vanille. La question est simple : y a-t-il de la vanille dedans ?
Si on ne regarde que l’avant de l’emballage, on aura, intuitivement, de bonnes raisons de croire que oui. Le mot « vanille » est souvent écrit en gros caractères, avec, à l’appui, une photo d’une superbe gousse. Ensuite, le fameux effet de halo fait son office : le consommateur va avoir tendance à se fier à sa première impression et ne va, bien souvent hélas, pas chercher plus loin.
C’est écrit dessous !
Mais c’est plutôt derrière qu’il faudrait chercher, en consultant la composition du produit. Mais là, évidemment, c’est écrit en tout petit, et dans le cas de glaces en boite, souvent en dessous. Il faut donc retourner le contenant pour avoir l’information. Pratique !
Si on a réussi ce premier jeu de piste, on tombe donc sur la liste des ingrédients. Rappelons-le : ils sont mentionnés par ordre décroissant de quantité. On va finir par trouver, aux environs de la 10e place sur cette liste, le fameux arôme qui va donner son goût au produit. Et c’est là qu’il faut être vigilant, car la mention précise est importante. Petit tour d’horizon des possibilités.

Arôme vanille. Là on est en présence d’une molécule de synthèse chimique qui reproduit le goût de la vanille. Dans certains produits, elle peut aussi reproduire des goûts qui n’existent pas à l’état naturel : par exemple, le goût barbecue de certains gâteaux apéritifs.
Arôme naturel. Il s’agit d’un ingrédient d’origine naturelle, végétale ou animale. Mais s’il n’y a pas d’autre précision sur notre pot de glace à la vanille, ce n’est pas de la vanille. Ça pourrait être des copeaux de bois, par exemple, mais dans le cas de la glace à la vanille, il s’agit probablement de lignine, un sous-produit de la pâte à papier, fermentée, qui produit des molécules de vanilline. L’intérêt pour le fabricant, on l’a bien compris, c’est que c’est moins cher que la vraie vanille. Pour le consommateur, c’est une autre paire de manches.
Arôme naturel de vanille. Enfin de la vanille ! Selon la législation, cette mention signifie qu’au moins 95% de l’arôme provient de l’ingrédient mentionné, la vanille en l’occurrence.
Extrait de vanille. Alors là, on touche au Graal ! L’extrait, réglementairement, est obtenu directement à partir de gousses de vanille.
Si la lecture de cet article vous a fait passer le goût de la glace à la vanille, sachez tout de même que le problème est évidemment le même avec la glace au chocolat ou à la fraise. Et tout ça vaut aussi pour les yaourts, les sirops, les pâtisseries, les confiseries, etc.
Bon appétit quand même!