SFAM : on en reparle
Le 9 janvier 2025, une nouvelle audience s’est tenue dans le cadre de l’affaire de la SFAM (Société française d’assurance multirisque) mais cette fois-ci ce sont des partenaires qui sont assignés notamment les assureurs MMA et Axéria et le groupe Fnac/Darty en tant que distributeur.
Retour sur l’affaire
 A l’origine, à partir de l’année 2017, lors de l’achat d’un téléphone ou d’une tablette dans les enseignes FNAC et DARTY (mais également dans les propres boutiques Hubside store du groupe SFAM), plusieurs centaines de consommateurs ont été invités à souscrire un contrat d’assurance dont les mensualités s’élevaient de 15,99 à 22.98 euros, en fonction des options souscrites.
A l’origine, à partir de l’année 2017, lors de l’achat d’un téléphone ou d’une tablette dans les enseignes FNAC et DARTY (mais également dans les propres boutiques Hubside store du groupe SFAM), plusieurs centaines de consommateurs ont été invités à souscrire un contrat d’assurance dont les mensualités s’élevaient de 15,99 à 22.98 euros, en fonction des options souscrites.
Or, dès 2018, des consommateurs constatent un certain nombre de prélèvements parfaitement infondés provenant de la SFAM, et sous différents intitulés : « SFAM », « INDEXIA », « CELSIDE », « HUBSIDE », « SERENA », « CYRANA » ou encore « FORIOU ». Les prélèvements se multiplient et certains clients se plaignent même de ne jamais avoir souscrit d’autres contrats d’assurance, contrats dont les mensualités sont néanmoins prélevées. Malgré les demandes nombreuses et réitérées de résiliation et de remboursement, les consommateurs lésés ne sont jamais remboursés et nombreux se tournent vers notre association l’UFC-Que Choisir pour les défendre.
Une première enquête avait mené à une première résolution en 2019 avec une transaction pénale de 10 millions d’euros.
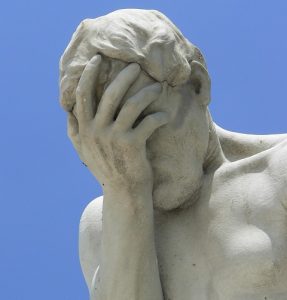 Hélas, malgré cela, les prélèvements ont continué pour de nombreux consommateurs victimes et aucune résiliation ou remboursement n’ont été fait malgré les relances. Difficultés financières, remise en cause de projets professionnels et perte de confiance, les conséquences sont énormes pour un grand nombre de ces victimes. Pour certaines, les sommes indument prélevées s’élèvent à plusieurs milliers d’euros.
Hélas, malgré cela, les prélèvements ont continué pour de nombreux consommateurs victimes et aucune résiliation ou remboursement n’ont été fait malgré les relances. Difficultés financières, remise en cause de projets professionnels et perte de confiance, les conséquences sont énormes pour un grand nombre de ces victimes. Pour certaines, les sommes indument prélevées s’élèvent à plusieurs milliers d’euros.
Pour exemple, rapportons le cas de monsieur R. qui avait souscrit pour 191.88 € annuellement. Il a été prélevé de :
- 243,78 euros TTC en 2018, au lieu de 191,88 euros, soit la somme 51,9 euros prélevée en plus,
- 454,81 euros TTC en 2019, soit la somme de 262,93 euros, prélevée en plus,
- 1.027,56 euros TTC en 2020, soit la somme de 835,68 euros, prélevée en plus,
- 1.585,48 euros TTC en 2021, soit la somme de 1.393,60 euros, prélevée en plus,
- 4.481,80 euros TTC en 2022, soit la somme de 4.289,92 euros, prélevée en plus,
- 17.072,59 euros TTC en 2023, soit la somme de 16.880,71 euros, prélevée en plus,
Soit la somme totale de 23 714, 74euros TTC, au titre de prélèvements infondés et ceci sans aucun engagement contractuel.
Tout s’accélère en 2024
En 2024, le Tribunal de commerce de PARIS a enfin prononcé la liquidation judiciaire de la SFAM et d’un certain nombre d’autres sociétés créées et dirigées aussi par le dirigeant et fondateur de la SFAM, Sadri Fegaier. Malheureusement, en cas de liquidation judiciaire, les clients sont remboursés en dernier après l’Etat (dont l’Urssaf et la Direction générale des finances publiques), les salariés et les fournisseurs de l’entreprise en liquidation.
Un procès en septembre
 En septembre 2024, devant la 31 e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, s’est ouvert le procès pour pratiques commerciales trompeuses de la SFAM, de cinq autres filiales (Cyrana, Foriou, Hubside, Serena, SFK) et surtout de son fondateur, Sadri Fegaier, présenté quelques années plus tôt comme le plus jeune milliardaire de France à la réussite insolente.
En septembre 2024, devant la 31 e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, s’est ouvert le procès pour pratiques commerciales trompeuses de la SFAM, de cinq autres filiales (Cyrana, Foriou, Hubside, Serena, SFK) et surtout de son fondateur, Sadri Fegaier, présenté quelques années plus tôt comme le plus jeune milliardaire de France à la réussite insolente.
Les victimes se succèdent à la barre pour raconter leur calvaire et dénoncer le système complexe mis en place pour décourager les demandes de résiliation et de remboursements.
Le 17 décembre, le PDG de l’entreprise est condamné à 24 mois de prison dont 16 mois ferme, à l’amende maximale de 300 000 euros et l’obligation de rembourser les victimes de l’entreprise. Les six sociétés du groupe sont condamnées à de lourdes amendes (de 150 000 à 1,5 million d’euros).
L’ancien patron a fait appel de sa condamnation. L’appel est suspensif et opère aussi dévolution : conséquence, l’homme sera de nouveau jugé en fait et en droit. Il échappe pour l’instant à cette condamnation, reste libre, présumé innocent au grand dam des parties civiles.
Du nouveau en 2025
 Nous avons appris qu’indépendamment du procès de la SFAM, une autre action sera prochainement engagée. Maitre Marine Lochon, avocate au barreau de Tours et qui défend des consommateurs lésés dans cette affaire, nous explique que cette « procédure est cette fois-ci engagée non pas à l’encontre de la SFAM, dans la mesure où celle-ci a été liquidée, mais à l’encontre notamment des sociétés MMA IARD, AXERIA IARD, QBE EUROPE, FNAC DARTY, en qualité de partenaires ou assureurs de la SFAM. » En effet, ces partenaires ou assureurs auraient leur part de responsabilité et n’auraient rien fait pour arrêter les prélèvements indus. Du reste, Maître Lochon explique que la diversité de parties (solvables) assignées, permet un réel espoir de voir les victimes de la SFAM indemnisées.
Nous avons appris qu’indépendamment du procès de la SFAM, une autre action sera prochainement engagée. Maitre Marine Lochon, avocate au barreau de Tours et qui défend des consommateurs lésés dans cette affaire, nous explique que cette « procédure est cette fois-ci engagée non pas à l’encontre de la SFAM, dans la mesure où celle-ci a été liquidée, mais à l’encontre notamment des sociétés MMA IARD, AXERIA IARD, QBE EUROPE, FNAC DARTY, en qualité de partenaires ou assureurs de la SFAM. » En effet, ces partenaires ou assureurs auraient leur part de responsabilité et n’auraient rien fait pour arrêter les prélèvements indus. Du reste, Maître Lochon explique que la diversité de parties (solvables) assignées, permet un réel espoir de voir les victimes de la SFAM indemnisées.
L’avocate tourangelle à l’initiative d’une procédure au niveau local, nous détaille le déroulé : « Une première audience a eu lieu le 9 janvier pour évoquer le dossier et le nombre de consommateurs impactés par ces prélèvements. Le Tribunal Judiciaire de Paris (4e chambre section 2) a renvoyé le dossier au 5 juin 2025, pour permettre aux autres consommateurs lésés d’intervenir d’ici-là à l’action en cours.
Elle précise qu’il « s’agit d’une procédure au civil visant la condamnation de ces organismes à indemniser les demandeurs à cette action en justice, c’est-à-dire les consommateurs victimes de prélèvements indus et toujours non remboursés à ce jour. Pour ce faire, toute personne intéressée peut encore intervenir à l’action. »
Pour info, les consommateurs d’Indre-et-Loire victimes ont jusqu’au 4 juin afin de se faire représenter par un avocat et intégrer, s’ils le désirent, cette procédure puisque l’audience de mise en état se tiendra le 5 juin 2025.
Restauration : la fin de la viande d’origine incertaine
Mais d’où vient donc le steak que j’ai dans mon assiette ?
Cette question, quand vous mangez au restaurant, il y a maintenant 3 ans qu’en principe vous n’avez plus à vous la poser, puisque depuis 2022, la loi oblige les restaurateurs à indiquer sur le menu ou par affichage l’origine de la viande bovine qu’ils proposent à leurs clients. Mais en matière d’information du consommateur, on restait sur sa faim quand on mangeait un pavé d’agneau, une côte de porc ou un poulet – frites.
Eh bien, c’est fini ! Un décret paru au Journal officiel le 13 février de cette année étend, dans la restauration, l’obligation d’information d’origine aux viandes porcines, ovines et à la volaille.
 Désormais, les restaurateurs ont donc l’obligation d’indiquer «origine… » si l’animal est né, a été élevé et abattu dans le même pays. Dans le cas contraire, ils devront indiquer séparément « né en… », « élevé en… » et « abattu en… ».
Désormais, les restaurateurs ont donc l’obligation d’indiquer «origine… » si l’animal est né, a été élevé et abattu dans le même pays. Dans le cas contraire, ils devront indiquer séparément « né en… », « élevé en… » et « abattu en… ».
Les consommateurs et les associations qui les défendent étaient évidemment demandeurs d’une plus grande transparence sur l’origine des produits. Mais ils ne sont pas les seuls : c’était aussi une revendication récurrente du monde agricole. Les éleveurs espèrent en effet que cette nouvelle réglementation favorisera chez le consommateur une appétence plus grande pour les produits identifiés comme français. Ce sera sans doute le cas, et la mention origine France restera, pour le convive, synonyme de qualité et d’exigence, à une condition toutefois : que les différents accords de libre-échange ne tirent pas, à terme, les normes vers le bas.
Trie ton pot (de yaourt) : c’est écrit dedans
Depuis le 1er janvier 2023, le tri sélectif des ordures ménagères a franchi une nouvelle étape : depuis cette date en effet, on est censé mettre dans sa poubelle jaune tous les emballages : pots, barquettes, sacs, sachets, films, et évidemment, pots de yaourts.
 Fini donc, en théorie, le casse-tête de savoir dans quelle poubelle mettre ses pots de yaourts vides. En théorie seulement, car le constat est sans appel : beaucoup sont encore déposés dans la poubelle à déchets. Les industriels ont donc décidé d’entrer dans la bataille via une campagne intitulée #TriTonPot. La quasi-totalité des fabricants de desserts frais y participeront, à l’exception notable de Danone, qui a pourtant déclaré « partager la même ambition de transparence et de pédagogie du consommateur sur l’importance du geste de tri ». Ça ne mange pas de pain.
Fini donc, en théorie, le casse-tête de savoir dans quelle poubelle mettre ses pots de yaourts vides. En théorie seulement, car le constat est sans appel : beaucoup sont encore déposés dans la poubelle à déchets. Les industriels ont donc décidé d’entrer dans la bataille via une campagne intitulée #TriTonPot. La quasi-totalité des fabricants de desserts frais y participeront, à l’exception notable de Danone, qui a pourtant déclaré « partager la même ambition de transparence et de pédagogie du consommateur sur l’importance du geste de tri ». Ça ne mange pas de pain.
Concrètement, cela se matérialise par un slogan que les consommateurs trouveront imprimé dans plusieurs centaines de millions de pots, une petite phrase toute simple du style « Je vais dans la poubelle jaune ». Cette campagne, démarrée le 22 février (jour de l’ouverture du Salon de l’agriculture) est prévue pour durer 6 mois. Un semestre pour inciter les Français à changer leurs habitudes, car aujourd’hui 25% des pots de yaourts partent encore dans la poubelle à déchets, c’est-à-dire, in fine, à l’enfouissement ou à l’incinération.
Le tri, c’est de l’argent !
Or l’enfouissement des déchets non-recyclables va coûter de plus en plus cher (avant d’être purement et simplement interdit à moyen terme). Donc moins il y en aura, moins on dépensera pour les éliminer. De surcroit, comme la France n’atteint pas ses objectifs de tri, elle paie actuellement chaque année 1,5 milliard d’euros de pénalités à l’Union européenne. Et ces pénalités, tout comme le prix de l’enfouissement ou l’incinération, ce sont les citoyens consommateurs qui les paient ; on voit tout de suite qu’il y a moyen de faire des économies.
Que deviennent les pots recyclés ?
 On l’a dit, les pots mis aux déchets sont éliminés. Mais qu’en est-il de ceux que l’on met dans la poubelle jaune ? Deux techniques sont possibles. La première, mécanique, consiste à les broyer et à les fondre. C’est la technique la plus répandue actuellement, mais elle ne permet pas de faire de nouveaux pots de yaourts, mais seulement des pare-chocs ou des pots de fleurs (ce qui n’est déjà pas si mal). La seconde chimique, consiste à porter les pots à très haute température pour retrouver la molécule initiale de styrène ; dans ce cas, on peut utiliser le produit obtenu pour en refaire des pots.
On l’a dit, les pots mis aux déchets sont éliminés. Mais qu’en est-il de ceux que l’on met dans la poubelle jaune ? Deux techniques sont possibles. La première, mécanique, consiste à les broyer et à les fondre. C’est la technique la plus répandue actuellement, mais elle ne permet pas de faire de nouveaux pots de yaourts, mais seulement des pare-chocs ou des pots de fleurs (ce qui n’est déjà pas si mal). La seconde chimique, consiste à porter les pots à très haute température pour retrouver la molécule initiale de styrène ; dans ce cas, on peut utiliser le produit obtenu pour en refaire des pots.
L’idéal serait bien évidemment que les pots de yaourts redeviennent des pots de yaourts, afin de ne pas consommer de matière première pour la confection de pots neufs. Mais le procédé chimique produit actuellement un polystyrène recyclé environ deux fois plus cher que le neuf. Pour rééquilibrer, voire inverser ce ratio, il faudrait augmenter sensiblement les volumes de recyclage pour baisser les coûts de production. Ce qui implique donc que les consommateurs trient mieux leurs déchets à la source.
Donc, vous savez ce qu’il vous reste à faire !
Poisson : entier ou en filets ?
Nombreux sont les amateurs de poisson qui préfèrent acheter leur produit déjà découpé en filets. C’est évidemment plus pratique : pas de manutention une fois arrivé à la maison, il suffit de cuisiner son filet sans passer par la case découpe. Ouf, une corvée de moins !

Mais d’abord, c’est quoi un filet de poisson ?
C’est une partie découpée le long de l’arête centrale, depuis l’avant jusqu’à la queue. En cela il se distingue du pavé qui, lui, est tranché uniquement dans la partie avant de la bête. La darne, elle, est prélevée perpendiculairement à l’arête centrale, en tranches.
Conséquence : la darne aura des fibres plus courtes, puisque coupées, et une portion de l’arête centrale (qui donne une saveur particulière à la chair), tandis que le pavé aura une texture plus charnue que le filet, étant donné que ce dernier va en s’amincissant vers la queue.
Alors, vaut-il mieux acheter son poisson déjà découpé ou entier ?
PRATIQUE. Là, il n’y a pas photo : on l’a dit, le filet est plus pratique puisque le travail de découpe est déjà fait. Avantage filet.
ARÊTES. A priori, un filet est la promesse de ne pas avoir d’arêtes dans le plat. Et quand on sait la galère que ça peut être de faire manger du poisson, par exemple à des enfants, quand il y a des arêtes, le filet, ça peut être la panacée. Avantage filet.
 PRIX. Le poisson en filets est plus cher, c’est indéniable. Mais il faut évidemment prendre en compte que quand on achète un filet de poisson, on n’achète pas certaines parties de l’animal que, de toute façon, on ne consomme pas : tête, queue, arêtes, nageoires… A moins de réutiliser tout ça pour faire une soupe ou du fumet. Égalité.
PRIX. Le poisson en filets est plus cher, c’est indéniable. Mais il faut évidemment prendre en compte que quand on achète un filet de poisson, on n’achète pas certaines parties de l’animal que, de toute façon, on ne consomme pas : tête, queue, arêtes, nageoires… A moins de réutiliser tout ça pour faire une soupe ou du fumet. Égalité.
FRAICHEUR. On apprécie la fraicheur d’un poisson en regardant les yeux, qui doivent être bombés et brillants, les ouïes, dont la couleur doit être vive, la peau qui doit avoir un aspect un peu gluant. Autant de détails qu’on ne peut évidemment pas contrôler sur des filets. Certains commerçants, un peu indélicats, auraient d’ailleurs tendance à découper en filets des poissons plus très présentables. Le problème, d’ailleurs, est similaire avec les langoustines ou les crevettes, dont la tête a tendance à noircir en vieillissant. Avantage poisson entier.
 RÉSULTAT. Chacun appréciera les avantages respectifs du poisson entier et des filets en fonction de ses moyens, du temps qu’il peut consacrer à la cuisine ou de ses habitudes culinaires. Cependant, la meilleure solution ne serait-elle pas d’acheter le poisson entier pour pouvoir contrôler sa fraicheur, et de faire lever les filets par son poissonnier pour s’éviter cette corvée ?
RÉSULTAT. Chacun appréciera les avantages respectifs du poisson entier et des filets en fonction de ses moyens, du temps qu’il peut consacrer à la cuisine ou de ses habitudes culinaires. Cependant, la meilleure solution ne serait-elle pas d’acheter le poisson entier pour pouvoir contrôler sa fraicheur, et de faire lever les filets par son poissonnier pour s’éviter cette corvée ?
Pour terminer, n’oublions pas que, quels que soient la présentation et le conditionnement du poisson, plusieurs indications doivent être obligatoirement étiquetées ou affichées : le mode et la zone de production ; s’il s’agit de pêche en eau douce, le nom du pays de pêche, et si c’est un poisson d’élevage, le pays également ; le type d’engin de pêche, et la congélation ou l’addition d’eau quand c’est le cas.
1 pour 0 ou 1 pour 1 ?
Derrière ce titre un peu énigmatique se cachent les règles de collecte d’équipements électriques usagés. Mais tout cela mérite quelques explications.
 1er exemple. J’achète une nouvelle machine à laver. Si tel est le cas, il y a fort à parier que l’ancienne n’est plus en état de fonctionner, sinon, pourquoi aller en acheter une autre ? Mais que faire de la vieille ?
1er exemple. J’achète une nouvelle machine à laver. Si tel est le cas, il y a fort à parier que l’ancienne n’est plus en état de fonctionner, sinon, pourquoi aller en acheter une autre ? Mais que faire de la vieille ?
A. Je la garde au fond de mon garage et je démarre une collection : avec l’obsolescence programmée, je peux espérer en accumuler, au fil des années, une petite dizaine.
B. Je la balance n’importe où dans la nature.
C. Je la dépose sur le trottoir devant ma porte.
D. Je l’apporte à la déchetterie.
E. Je demande à celui qui m’a vendu le nouveau lave-linge de reprendre l’ancien.
Réponse. Si vous avez coché B, vous avez tout faux, et en plus, vous risquez une amende très salée. Si vous avez coché A, pourquoi pas, mais vous risquez de vous attirer des remarques un peu acerbes de votre conjoint(e). Si vous avez coché C, ce n’est une bonne réponse que si votre commune organise des collectes d’encombrants au porte à porte, et si vous vous y êtes inscrit ou si c’est le jour prévu pour le ramassage. Les deux vraies bonnes réponses sont D et E. On peut évidemment porter sa vieille machine à laver en déchetterie. Mais si on ne veut pas s’embêter, on peut demander au magasin où on achète le nouvel appareil de nous débarrasser de l’ancien.
C’est le principe du 1 pour 1 : j’achète 1 appareil, on doit m’enlever gratuitement 1 appareil ancien, si je le demande. Ce qui veut dire qu’à l’inverse si je n’achète rien, ce n’est pas la peine d’essayer de refourguer mon lave-linge HS à Darty ou Boulanger.
Exemple 2. Mon grille-pain ne fonctionne plus, mais en fait je n’en ai plus l’utilité. Qu’est-ce que j’en fais ?
A. Je le mets à la poubelle.
B. Je le rapporte dans un magasin qui n’en vend pas.
C. Je l’emmène à la déchetterie.
D. Je le rapporte dans un magasin qui en vend.
Réponse. Si vous avez coché A, vous avez faux. Il ne faut jamais jeter les appareils électriques dans la poubelle à déchets. Ils peuvent contenir des éléments polluants, voire exploser si vos déchets vont à l’usine d’incinération. Cela est valable pour les piles et les ampoules usagées. Vous pouvez toujours tenter la solution B, mais si vous rapportez vos piles usagées à la boulangerie, vous risquez fort de n’être pas bien accueilli. La réponse C, l’apport en déchetterie est, dans tous les cas, une bonne réponse.
Reste la solution D : c’est le 1 pour 0. Je peux reporter en magasin 1 produit usagé et en acheter 0. A plusieurs conditions toutefois :
– que le magasin en question vende effectivement des produits équivalents ;
– que l’appareil électrique en question ait des dimensions inférieures à 25cm ;
– que la surface de vente soit supérieure à 400m2.
Des cœurs de palmier cueillis et rangés… à deux mains, si vous le voulez bien !
Un de nos adhérents a récemment acheté une boite de cœurs de palmier, de la marque Comte de la Charnaye, et son attention a été attirée par la mention « cueillis et rangés à la main ».
Laissant son imagination vagabonder, il a imaginé Monsieur le comte de la Charnaye, partant de bon matin avec son panier en osier sous le bras pour la cueillette des cœurs de palmier, soupesant le produit par-ci, tâtant pour apprécier la maturité par-là, puis regagnant les cuisines du château pour disposer amoureusement chaque cœur, bien aligné, dans les boîtes de conserve, avant de passer à la stérilisation.
Eh bien non ! Au risque de briser les rêves bucoliques de certains, il nous faut dévoiler une réalité plus prosaïque.
D’abord, les cœurs de palmier, ou choux palmistes, ça ne pousse pas en Europe, dans les vergers d’un manoir de province. En très grande majorité, ils viennent d’Amérique du sud. Ils peuvent être cultivés, mais souvent, il s’agit de palmiers sauvages.

Ensuite, s’ils sont cueillis à la main, c’est tout simplement que la mécanisation de la récolte serait extrêmement difficile. Les palmiers n’ont botaniquement pas de tronc, mais un stipe, dont les fameux cœurs de palmier sont l’extrémité. Et pour ce qui est de les ranger manuellement, il faut comprendre que ces cœurs de palmier doivent être notamment calibrés et recoupés avant d’être mis en boîte. Une opération, là encore, difficilement mécanisable.
Bref, plutôt que de nous servir de jolies formules finalement bien creuses, Monsieur le comte serait bien inspiré de fournir des précisions autrement plus importantes pour l’information du consommateur : la provenance, par exemple ; ou encore le type de végétal en question : s’agit-il de palmiers sauvages ou cultivés ?
Le sel et le sucre : deux amis qui ne vous veulent pas du bien !
Si le sel a sa place dans une alimentation équilibrée, il est recommandé par l’OMS de n’en prendre que 5 à 6 grammes par jour (ce qui équivaut à une cuillère à café environ). Actuellement, nous en consommons en moyenne 10 à 12 grammes par jour, ce qui peut favoriser l’hypertension, dont souffrent 12 millions de Français. Il augmente le risque de maladies cardio-vasculaires et son apport doit être limité en cas d’insuffisance cardiaque avec œdèmes (des membres inférieurs ou du poumon).
Le sel est un ingrédient bon marché qui donne de la saveur aux aliments. Il est également utilisé comme conservateur et l’industrie agro-alimentaire en utilise beaucoup, voire beaucoup trop.
Comment mesurer le sel dans votre alimentation ?
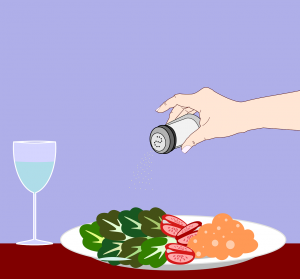 Tout d’abord, à table, ayons la main légère avec notre salière même si ce n’est pas le sel qu’on met dans notre assiette qui est le plus toxique.
Tout d’abord, à table, ayons la main légère avec notre salière même si ce n’est pas le sel qu’on met dans notre assiette qui est le plus toxique.
Surtout, traquons les sels cachés dans les produits industriels. Près de 8 /10ème du sel que nous consommons en proviendrait. Par exemple, quand vous achetez un plat préparé, détaillez la liste et le poids des ingrédients (le sel est mentionné parfois chlorure de sodium). Privilégiez la cuisine faite maison, pensez aux épices pour diminuer ou remplacer le sel.
La guerre du sucre
Pareillement, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a actuellement pour objectif une diminution de 25 % (soit 20 g) de notre consommation quotidienne de sucres. En effet, nous consommons actuellement en France environ trente kilos de sucres par an ! Les glucides sont partout sous différentes formes : d’un côté, il y a les sucres simples qui sont le glucose et le fructose, présents dans la plupart des produits végétaux (fruits, légumes…), le lactose et le galactose, naturellement présents dans les produits laitiers et le saccharose (le sucre de table) et de l’autre les glucides complexes, sources d’amidon, présents dans le pain, les céréales, les pommes de terre et autres féculents.
Attention aux sucres ajoutés
 L’Anses recommande de diminuer dans notre alimentation le pourcentage de sucres simples et d’augmenter le pourcentage de glucides complexes. Pour cela, elle s’attaque aux sucres ajoutés dans les plats cuisinés, dans les conserves, dans nos boissons…
L’Anses recommande de diminuer dans notre alimentation le pourcentage de sucres simples et d’augmenter le pourcentage de glucides complexes. Pour cela, elle s’attaque aux sucres ajoutés dans les plats cuisinés, dans les conserves, dans nos boissons…
Il faut savoir qu’une petite bouteille de soda peut contenir jusqu’à treize morceaux de sucre, un pot de célèbre pâte à tartiner de 400 g jusqu’à trente morceaux de sucre, et que même une pizza barbecue contient quatre sucres et demi !
Nous consommons trop de sucres simples qui créent une dépendance physique et psychique, qui favorisent l’obésité et le diabète mais aussi de nombreuses autres maladies telles que les maladies cardiovasculaires et certains cancers (côlon, estomac…).
Alors, comment réduire notre consommation de sucres simples ?
Il est possible de diminuer notre consommation d’aliments et de boissons les plus sucrés, en repérant les glucides sur les étiquettes des produits cuisinés, en cuisinant des produits frais… A contrario, les édulcorants ne semblent pas être spécialement bénéfiques dans le contrôle de la glycémie dans le cas de diabètes.
CB VOLEE : il faut agir vite !
Souvent, quand on perd ou qu’on se fait voler sa carte bancaire, on ne sait pas trop comment procéder. Et c’est encore plus vrai quand on est loin de chez soi, en vacances, par exemple.
 Pourtant, il faut vraiment agir très vite. Première chose, il faut tout de suite faire opposition pour bloquer les paiements à venir. Cela se fait par téléphone, avec le numéro communiqué par votre banque, ou via le service interbancaire d’opposition à carte bancaire au 0 892 705 705 (attention c’est un numéro surtaxé). On vous donne à ce moment-là un numéro d’enregistrement à conserver : c’est la trace datée de votre opposition. Cela déclenche le blocage immédiat des paiements par carte bancaire. Alors attention, c’est irréversible ! Si vous retrouvez votre carte bancaire après, elle ne vous servira plus à rien.
Pourtant, il faut vraiment agir très vite. Première chose, il faut tout de suite faire opposition pour bloquer les paiements à venir. Cela se fait par téléphone, avec le numéro communiqué par votre banque, ou via le service interbancaire d’opposition à carte bancaire au 0 892 705 705 (attention c’est un numéro surtaxé). On vous donne à ce moment-là un numéro d’enregistrement à conserver : c’est la trace datée de votre opposition. Cela déclenche le blocage immédiat des paiements par carte bancaire. Alors attention, c’est irréversible ! Si vous retrouvez votre carte bancaire après, elle ne vous servira plus à rien.
Et après, que faut-il faire ?
Il faut vérifier sur ses comptes, pendant quelques jours, afin de voir s’il y a eu des opérations frauduleuses. Si c’est le cas, demandez à votre banque le remboursement des sommes volées, c’est une obligation pour elle de vous rembourser, sauf s’il y a eu négligence ou faute avérée de votre part mais faut-il encore que la banque le prouve. Attention, si vous ne faites pas opposition assez rapidement, la banque peut invoquer cela comme une négligence.
Est-ce que la banque doit rembourser l’intégralité des sommes volées ?
 Cela dépend.
Cela dépend.
Premier cas de figure : le code de votre carte n’a pas été utilisé. La banque vous rembourse intégralement, sans frais.
Deuxième cas de figure : votre code a été utilisé. Dans ce cas, il y a une franchise de 50€ qui s’applique. Donc, si le vol n’excède pas 50€, vous ne touchez rien. Au-delà, vous êtes remboursé des sommes volées moins 50€.
Il faut donc toujours être vigilant avec sa carte!
Il est évident qu’il faut toujours être vigilant avec sa carte : par exemple il ne faut pas la quitter des yeux pendant un paiement. Et puis, il faut éviter les négligences qui peuvent dispenser la banque de vous rembourser, comme par exemple marquer votre code secret sur la carte ou sur un papier rangé avec votre carte.
Si vous avez un différend avec votre banque, vous pouvez saisir le médiateur bancaire. Si le litige persiste, il faudra vous tourner vers le juge des contentieux de la protection (ex juge du tribunal d’instance) s’il s’agit d’un litige jusqu’à 10 000 €, ou vers le tribunal judiciaire pour des sommes supérieures à 10 000 €.
La revanche du ver de farine
Tous ceux qui font la cuisine connaissent et redoutent le fameux ver de farine, qui se loge dans les pots de farine pour se nourrir et remonte à la surface pour muer et se métamorphoser. Sa présence est assez peu ragoûtante, il faut bien le reconnaître, et c’est pourquoi, pour s’en prémunir, on a pris l’habitude de conserver la farine, quand on le peut, dans des récipients étanches.
 Ce Tenebrio molitor, c’est son nom scientifique, tenebrion meunier pour la traduction française, doit son nom au fait qu’il avait jadis l’habitude de coloniser les moulins, là précisément où il pouvait trouver à satiété son mets préféré : la farine. Traqué, pourchassé, sa réputation n’était pas des plus reluisantes, et il était obligé de vivre constamment dans la clandestinité, à l’insu des propriétaires des lieux, alors qu’il est totalement inoffensif.
Ce Tenebrio molitor, c’est son nom scientifique, tenebrion meunier pour la traduction française, doit son nom au fait qu’il avait jadis l’habitude de coloniser les moulins, là précisément où il pouvait trouver à satiété son mets préféré : la farine. Traqué, pourchassé, sa réputation n’était pas des plus reluisantes, et il était obligé de vivre constamment dans la clandestinité, à l’insu des propriétaires des lieux, alors qu’il est totalement inoffensif.
 Mais ça, c’était avant. Car dès ce lundi 10 février, l’heure de la revanche sonne pour le Tenebrio molitor. Et celle-ci, est, disons-le clairement, éclatante. L’Union européenne vient en effet d’autoriser l’incorporation de larves de vers de farine, réduites en poudre, dans certains aliments comme le pain, les pâtes, le fromage ou les gâteaux. Dès lundi donc, on pourra incorporer de la farine, ou plus exactement de la poudre, de vers de farine dans certains aliments. En quantité limitée, certes (par exemple pas plus de 4% dans le pain), et à condition de le préciser expressément sur l’emballage.
Mais ça, c’était avant. Car dès ce lundi 10 février, l’heure de la revanche sonne pour le Tenebrio molitor. Et celle-ci, est, disons-le clairement, éclatante. L’Union européenne vient en effet d’autoriser l’incorporation de larves de vers de farine, réduites en poudre, dans certains aliments comme le pain, les pâtes, le fromage ou les gâteaux. Dès lundi donc, on pourra incorporer de la farine, ou plus exactement de la poudre, de vers de farine dans certains aliments. En quantité limitée, certes (par exemple pas plus de 4% dans le pain), et à condition de le préciser expressément sur l’emballage.
Ce ténébrion a, il faut le dire, quelques arguments à faire valoir, notamment sa richesse en protéines et en vitamines et son impact environnemental bien moindre que celui de l’élevage traditionnel.
Ce retour en grâce du ténébrion, ce pauvre petit insecte qui n’a jamais fait de mal à une mouche, pourrait apparaître comme un juste retour des choses, après qu’il a été, durant tant d’années, vilipendé, pourchassé, à défaut d’avoir pu être exterminé. Mais ce regain de popularité est en fait une victoire à la Pyrrhus, puisque pour figurer, au grand jour, aux menus de nos tables, Tenebrio molitor devra faire le sacrifice de sa vie : les larves seront traitées aux UV et réduites en poudre avant d’être utilisées en cuisine.
On n’a rien sans rien !